Le monstre qu’à la fin on devient – sur Nightmare Alley de Guillermo Del Toro
On a souligné la facture classique du dernier film de Del Toro, son respect scrupuleux des codes du film noir et de sa mythologie, ainsi que le rôle flamboyant qu’il a offert à Bradley Cooper, qui rappelle en effet les plus belles heures de Robert Mitchum ou d’Humphrey Bogart.
On a moins commenté les échos plus contemporains du film, le fait que le rôle de femme fatale de Cate Blanchett (elle aussi flamboyante) a beaucoup en commun avec son rôle de présentatrice vedette dans Don’t Look Up (Adam McKay, 2021), ou encore certaines proximités esthétiques et thématiques du film avec Titane (Julia Ducournau, 2021) : les plans lancinants sur les flammes allumées par le personnage principal pour faire table rase de son passé, de sa filiation, comme pour s’engendrer lui-même ; la quête tortueuse, ensuite, d’un père de substitution (Vincent Lindon dans Titane, plusieurs figures d’autorité incarnées successivement par Willem Dafoe, David Strathairn et Richard Jenkins dans Nightmare Alley) ; enfin la conclusion des deux films sur l’image d’un bébé (ou d’un fœtus) monstrueux, ou mutant, qui pose de façon énigmatique la question d’une génération alternative ou défectueuse.
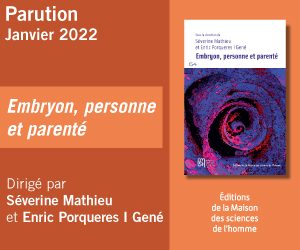
L’action du film se déroule à la veille de la Seconde Guerre mondiale (Del Toro insiste même assez lourdement sur la catastrophe qui survient, en montrant des journaux ou en faisant entendre des annonces radiophoniques), dans une Amérique qui a été marquée à la fois par la Première Guerre et par la Grande Dépression.
Au début du film, ce sont d’abord des motifs économiques qui poussent Stanton Carlisle (Bradley Cooper) à se faire employer par une troupe de forains : c’est un prolétaire, au sens où il ne possède rien d’autre que son corps et sa force de travail. La petite société qu’il rejoint alors est, à son échelle, une parabole du capitalisme : en haut Hoately, le patron (William Dafoe), figure paternelle et initiatique, tantôt bienveillante et tantôt cruelle, la troupe des freaks, entrepreneurs d’
