La société des scélérats
« Je m’avance vers celui qui me contredit. »
Montaigne
Dans cet article, nous allons analyser les ramifications de l’incapacité à dialoguer, qui est bien le problème des problèmes auquel nous sommes confrontés dans nos sociétés développées, puisque, par définition, aucune résolution collective des problèmes ne peut s’amorcer sans mettre en présence les épineux partenaires des dits problèmes.
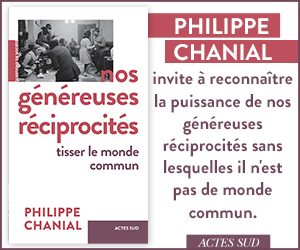
Le dialogue impossible
Aux États-Unis, lors de l’assaut du Capitole, des gens meurent à balles réelles dans l’enceinte du parlement. Depuis deux décennies, le fossé ne cesse de s’approfondir entre les Bleus (les Démocrates) et les Rouges (les Républicains). Cependant, le fil du dialogue des différences n’y est pas rompu : une association, Braver Angels, organise des débats entre les partisans des deux camps sur des questions clivantes.
Une sociologue de Berkeley, Arlie Russell Hochschild, appelle, dans Strangers in their own land, à « escalader le mur de l’empathie » pour comprendre les « sentiments profonds » des électeurs de la droite américaine. De gauche, progressiste, elle montre l’exemple d’un dialogue qui part en quête, qui écoute, qui se laisse affecter par la vie de l’autre, de droite – et elle découvre des raisons qui font, par exemple, que des ouvriers d’industries polluantes de Louisiane, mourant de maladies professionnelles, votent quand même contre les règlements environnementaux de l’État fédéral.
Et en France, où en sommes-nous ? Chez nous, pas de morts au Parlement, mais la pratique du dialogue y est peut-être encore plus dévastée qu’outre-Atlantique. La trumpisation des esprits est bien là. Elle surfe sur des stratégies de clivage pour capter des suiveurs, prendre le pouvoir ou le conserver. Trump en a rendu explicite la méthode dès les années 1980 dans un bestseller : « la controverse aidait à maintenir une présence dans les médias », écrivait-il.
Arnaud Benedetti (dans Le Figaro, le 5 janvier 2022) en arrive à parler d’un « trumpisme des élites » à
