Comment le Kremlin justifie la guerre contre l’Ukraine
La guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine est une guerre réelle, menée aujourd’hui par des armées russes sur le territoire d’un pays voisin. Mais toute guerre, qu’on la juge « juste » ou non d’un point de vue philosophique[1], se fonde sur un dispositif narratif visant à justifier l’action militaire, voire la dédoubler sur le plan symbolique. C’est pourquoi il semble important de contextualiser les éléments de langage et la rhétorique du régime poutinien concernant l’Ukraine et les Ukrainiens pour pouvoir mieux comprendre son raisonnement.
Le dispositif narratif déployé par les dirigeants de la Russie contient trois volets principaux – un sécuritaire, un historique et un nationaliste – et reflète une rigidification idéologique du régime de Vladimir Poutine, celui qui a longtemps vanté son « pragmatisme[2] ». Mais la préférence pour des solutions concrètes, en phase avec les ressorts kleptocratiques du régime poutinien[3], semble avoir cédé au recyclage des constructions idéologiques de plus en plus radicales. Ce processus de rigidification, entamé dès les années 2000 et renforcé en 2014, a atteint son apogée ces derniers mois.
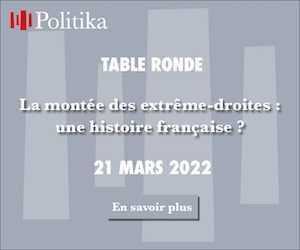
Le volet sécuritaire : attaquer l’Ukraine en visant l’Occident
Dans son discours du 24 février dernier annonçant « l’opération militaire spéciale » contre l’Ukraine, Vladimir Poutine décrit ce pays comme un État soumis aux Occidentaux, qui l’utiliseraient comme un territoire d’appui pour exercer une pression militaire sur la Russie. Celle-ci n’aurait d’autre choix que de « se défendre » en attaquant, dixit le chef du Kremlin. Mais en attaquant l’Ukraine, la première puissance militaire d’Europe vise « l’Occident collectif », c’est-à-dire l’OTAN. L’objectif de « démilitariser » l’Ukraine relève, dans la vision des choses exposée par Poutine, d’une confrontation entre la Russie et l’Occident dont les prémices remontent aux années 2000, avec la révolution orange en Ukraine. C’est après la défaite du candidat « pro-russe » Viktor I
