Sommes-nous en guerre ?
«La France est en guerre », déclare François Hollande, le 16 novembre 2015, aux députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles après les attentats du 13 novembre. Phrase également utilisée à plusieurs reprises par le Premier ministre de l’époque Manuel Valls. Dans son allocution du 16 mars 2020 consacrée à la covid-19, le président Emmanuel Macron répète six fois la phrase : « nous sommes en guerre ». Pour renforcer le message, il égrène dans ses discours lors de la pandémie des citations de Georges Clemenceau. Notamment cette phrase à propos des soignants, « ils ont des droits sur nous », que Clemenceau avait utilisée pour évoquer les Anciens combattants après la Première guerre mondiale. Dans aucun de ces deux cas (terrorisme et covid), la « déclaration de guerre » n’a été suivie de discours de « paix », encore moins de « victoire ». Cela signifierait-il que, faute de paix, nous soyons encore en guerre ?
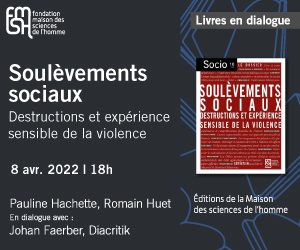
La question revêt un sens nouveau dans l’actuel contexte de guerre – une vraie guerre –en Ukraine. Et comme l’histoire n’est pas avare d’ironie, cette fois, justement, l’un des principaux protagonistes réfute l’utilisation du mot. Vladimir Poutine préfère évoquer « des opérations militaires spéciales » visant au « maintien de la paix ». Non seulement le mot guerre n’est pas utilisé, mais il est, de fait, interdit d’usage en Russie. Dès le 24 février, le jour du déclenchement des opérations, le Roskomnadzor, c’est-à-dire le service fédéral de supervision des communications, a prévenu que le fait de qualifier l’opération militaire en cours d’ « invasion », d’ « attaque » ou de « guerre » serait considéré comme une « fausse » description des faits. Une fake news, dirait-on ici. Or, le « code des infractions administratives de la Fédération de Russie », prévoit une amende administrative et des sanctions pour quiconque « diffuse intentionnellement de fausses informations ».
Ces mesures ont été renforcées le 4 mars, par le vote d’une loi qui prévoit des p
