L’Europe centrale enrôlée dans la guerre en Ukraine
La guerre est, on le sait, un fait social total. Elle implique, au sens fort d’impliquer, l’ensemble des secteurs des sociétés directement concernées : le politique, le militaire, le sanitaire, l’éducatif, l’économique, le culturel, etc. Portée par une logique d’exclusion, elle incite à des dynamiques de solidarité et de fraternité. Crise multidimensionnelle, elle peut fonder des mécanismes d’institution. Rupture, voire fin d’une époque, elle peut inaugurer des temps nouveaux. Concentrée sur un territoire précis correspondant à des objectifs martiaux plus ou moins déclarés, sa géographie est en réalité extensive.
La guerre en Ukraine contient certainement l’ensemble de ces propriétés. Sa capacité d’enrôlement, ne serait-ce qu’à l’échelle de l’Europe, est évidente. L’Europe centrale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) est de ce point de vue en première ligne. Par sa proximité géographique (trois pays de la région ont une frontière avec l’Ukraine) et l’appartenance à un même sous-espace de la globalisation, ses liens historiques avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie (une histoire partagée pendant des siècles jusqu’à celle, récente, du soviétisme) et une expérience contrastée du post-communisme, cette partie de l’Europe est confrontée à de nombreux défis qui s’accompagnent d’effets-miroir éprouvants teintés d’ambiguïtés.
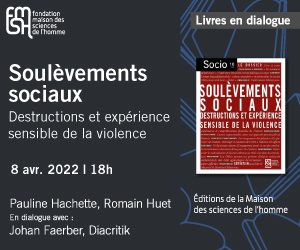
Un enrôlement à plusieurs dimensions
L’exode de plusieurs millions de personnes fuyant l’Ukraine est évidemment le phénomène le plus visible, mais il n’est peut-être pas le plus significatif. Les pays d’Europe centrale ne découvrent pas subitement les Ukrainiens à la faveur de la guerre. La région est historiquement une terre de sangs mêlés et de coexistence plus ou moins pacifique entre groupes ethniques et culturels, qualifiés de « minorités nationales ». Les rapports entre Ukrainiens et Polonais en particulier s’inscrivent dans une histoire longue, une partie de l’actuelle Ukraine ayant été sous l’autorité du royaume de
