Poutine, les « drogués » et nous
Dans une intervention télévisée diffusée le 25 février dernier, Vladimir Poutine appelait au renversement du gouvernement ukrainien qu’il qualifiait de « bande de toxicomanes et de néo-nazis ». Si l’on a justement dénoncé l’objectif de « dénazification » brandi par les autorités moscovites comme un mensonge éhonté, le recours à la catégorie du drogué (наркоман / narkoman) pour décrédibiliser le Premier ministre Zelensky et son équipe est passé largement inaperçu[1].
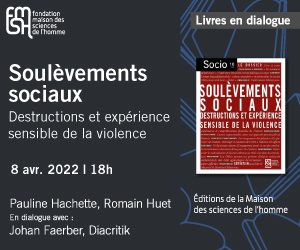
Cette rhétorique qui dépeint l’usager de stupéfiants comme une menace justifiant sa mise à l’écart mérite pourtant d’être mise en lumière. Elle est à l’image de la politique anti-drogue mise en œuvre dans la fédération de Russie et témoigne d’une toxicophobie qui n’est, malheureusement, pas l’apanage du président Poutine.
L’addictologie russe est l’héritière des standards répressifs de la psychiatrie soviétique[2]. Elle demeure hermétique à la logique de la réduction des risques. En dépit des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, la méthadone et la buprénorphine ne peuvent être prescrites aux personnes toxicodépendantes. Ces traitements de substitution aux opiacés, qui étaient disponibles en Crimée jusqu’en 2014, y ont été interdits immédiatement après l’annexion de ce territoire par la Russie[3].
Détenant un nombre d’injecteurs parmi les plus élevés au monde, la fédération de Russie paie au prix fort les conséquences de cette politique répressive.
L’offre médicamenteuse proposée aux usagers de drogues en demande de soins est désormais réduite à une prescription de tramadol qui ne doit pas excéder dix jours[4]. Les autorités sanitaires russes privilégient la diabolisation des consommateurs de stupéfiants à l’information sur les risques associés à leurs pratiques. L’objectif de « réhabilitation sociale » de celles et ceux qui s’adonnent aux drogues illicites est mise en œuvre au moyen de mesures telles que la détection des consommateurs à l’école et sur leur lieu de travail, un
