Les nouveaux habits de l’empereur extractiviste
On raconte que quelques jours avant le « massacre de Bettogli » de 1911 – un éboulement ayant tué 10 ouvriers des carrières de marbre de Carrare (Italie) – certains travailleurs (cavatori) avaient averti leurs patrons : quelque chose clochait, « la montagne chantait[1] ».
Dans ces contrées transalpines, le capitalisme n’en était qu’à ses débuts à cette époque, mais le démon guidant son ascension impérieuse et vorace se manifestait déjà clairement dans cet événement tragique. Sous le capitalisme la « nature » ne chante pas, ne communique pas. Elle se prête silencieusement à une gestion et à une domination par les humains (« les hommes », aurait-on dit), vouée à une productivité marchande : ce qui est vrai en général doit l’être encore plus fatalement lorsqu’il s’agit du secteur « non vivant » de celle-ci, en particulier le royaume minéral. En réalité, quelqu’un avait su écouter la montagne, prêter attention à son chant, mais les patrons des cave n’ont su écouter que la mélodie de leur argent, en laissant les travailleurs crever sous la montagne qui s’effondrait… Alors la conscience du potentiel de délitement d’une pierre comme le marbre blanc a atteint même le quartier parisien de la Défense[2].
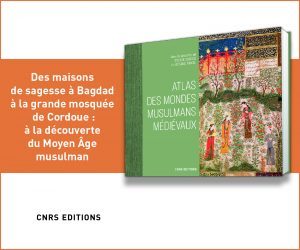
Ce genre de situations sont bien connues de la critique écologique contemporaine. Elles peuvent être regroupées sous la rubrique « extractivisme », un terme devenu de plus en plus courant pour désigner une attitude d’exploitation technique des milieux vivants aveugle aux réciprocités et aux équilibres qui les entretiennent. Bien que les plantations coloniales puissent en représenter une occurrence exemplaire (y compris dans leur déclinaison ultra-technologisée de multinationales comme Monsanto), le cas des activités minières demeure l’exemple le plus brutalement littéral de ce qu’extraire veut dire[3].
La partition est un engrenage crucial de l’extraction, à tout niveau : diviser les parties de la réalité, y sélectionner certains fragments « significatifs-parce-que-capitalisables », ensuite les mobiliser dans les circuits de valorisation productive et commerciale. Qu’est-ce qu’on ferait d’autre lorsqu’on isole et extrait des données exploitables des enchevêtrements affectifs et expressifs complexes de nos environnements de vie numériques ? À l’opposé de l’écologie radicale qui nous révèle aujourd’hui les continuités et les interdépendances spécifiques à chaque domaine de la réalité, le réductionnisme tisse la trame épistémologique nécessaire aux dynamiques extractivistes. Comme l’a souligné le physicien et épistémologue Marcello Cini il y a de nombreuses années : « La réduction d’un bien à une marchandise implique toujours qu’une valeur quantitative lui soit attribuée, et donc que l’unité de mesure de celle-ci soit définie. On constate donc que le réductionnisme épistémologique est la condition préalable au réductionnisme de marché. L’exemple le plus évident est le réductionnisme génétique. Ce n’est que si un gène est doté d’une propriété spécifique, indépendante du contexte, qu’il peut être privatisé au moyen d’un brevet et mis sur le marché avec une valeur spécifique. Si, en revanche, il est reconnu – comme le montrent les récents progrès de la génétique – que les propriétés d’un gène dépendent du contexte intracellulaire et des messages du reste de l’organisme et du monde extérieur, la revendication de la propriété intellectuelle perd sa justification « scientifique » et révèle sa véritable nature d’appropriation privée, vulgairement de vol, d’un bien commun[4]».
Ce sort a été réservé à la chaîne des Alpi Apuane, composée essentiellement de marbre, qui couronne l’ancienne Carrare : un environnement vivant et partagé réduit à quantité de pierre privatisée, mais aussi en poudre, à vendre. Il s’agit essentiellement de matériel brut alimentant le productivisme industriel et restant occulté à l’intérieur de celui-ci. Ainsi, la montagne moulue se retrouve dans les colles ou le dentifrice que nous utilisons le soir en regardant peut-être par la fenêtre de la salle de bain ces mêmes montagnes, sans pouvoir entendre au-delà des vitres et du frottement de notre brosse leur chant spectral.
Rendre tangible politiquement le diagramme refoulé qui regroupe la pâte à la menthe qui blanchit nos dents, la destruction d’un milieu naturel et l’accumulation financière est le point de départ d’un trajet amenant de la réduction extractiviste à une réduction de l’extraction. Ce diagramme transalpin fera écho à d’autres qui se dessinent depuis la France, comme celui que la création audiovisuelle du « militant hors-sol » Seumboy Vrainom agence entre la séduction publicitaire d’une série de smartphones et la dévastation des mines de Manono au Congo[5].
Extraire mieux vs. extraire moins
Il y a quelques années, le journal satirique grenoblois Le postillon lançait une campagne provocatrice pour demander l’inauguration de mines dans les alpes iséroises pour que la glorieuse French Tech localement célébrée assume jusqu’au bout (c’est-à-dire au cœur de la beauté des montagnes environnantes) les implications minières de ses activités « innovantes »[6]. L’ironie critique du canard de Grenoble s’est faite prophétiquement rattraper par la réalité : tout récemment des hypothèses d’ouverture de mines de lithium sur le sol hexagonal sont mises en circulation avec le sceau du Ministère de la Transition énergétique[7].
En effet, à la lumière de l’actualité du débat sur la relocalisation des activités productives, la perspective du rapatriement de l’extraction minière sur le territoire national est de moins en moins une polémique ironique et se retrouve donc analysée dans des cercles économiques et politiques respectables[8]. Un ensemble de raisons, parfois émergeant de champs adverses mais potentiellement complémentaires, semblent animer ces discussions : de la nécessité géopolitique de sécuriser l’approvisionnement de matières premières fondamentales pour ne pas dépendre de puissances étrangères (comme la Chine ou la Russie) à l’espoir écologiste de pouvoir instaurer des conditions d’extraction plus « soutenables » et « règlementées » sur le territoire européen.
Évidemment, la centralité des technologies numériques et du transport électrique dans les politiques industrielles occidentales joue aujourd’hui un rôle crucial dans l’attention prêtée aux questions minières et aux hypothèses de nouveaux extractivismes riverains. Puisque l’inédite mobilité contemporaine – tant de l’information que des individus, du smartphone aux green cars – se rêve depuis le sommeil immobile des gisements souterrains. Son âme minérale a été déterrée ces dernières années par de nombreuses enquêtes, mettant en exergue entre autres ses implications post-coloniales, comme celles de Guillaume Pitron[9]. De telles analyses dialoguent aujourd’hui avec les potentiels enjeux néocoloniaux de l’invasion russe à contextualiser (aussi) dans une optique d’accaparement de ressources matérielles de plus en plus rares à terme et d’une position de force dans le système global de l’extraction fossile du pays de Poutine[10].
En intervenant en porte-parole de l’association SistExt, Aurore Stephant a récemment[11] rappelé l’importance multiforme des matières minérales dans la chaine productive globale (même là où l’on ne l’imagine pas) et, en même temps, l’impact ravageur des processus d’extraction de celles-ci (échappant, par ailleurs, à certains éco-indicateurs hégémoniques comme le bilan carbone).
Dépouillé par des analyses comme celles d’Aurore Stephant ou Guillaume Pitron, l’empereur minier tente de cacher sa nudité en s’inventant de nouveaux habits et, donc, une nouvelle dignité, assisté par les ciseaux habiles des tailleurs politiciens : ainsi se fabrique la mythologie d’un « green extractivism », à savoir d’une extraction minière alternative et vertueuse[12]. Même s’il est possible d’isoler certaines exploitations minières particulièrement dangereuses et hors de contrôle (comme le souligne l’ingénieure de SistExt), la mine « propre » n’existe pas et la réduction globale de la demande de minerai constitue la meilleure condition pour réduire ses conséquences. Davantage qu’extraire vert, équitable et local, il s’agit de moins extraire dans une optique de consommation restreinte de ressources[13].
Comme les exemples les plus effrayants de cet extractivisme se trouvent avant tout dans les pays économiquement plus pauvres, il nous arrive d’observer ces phénomènes depuis un certain éloignement ou exotisme, en imaginant pouvoir les transformer magiquement par leur rapatriement. Ce qui, par ailleurs, tend à nous faire le plus peur visuellement (c’est-à-dire les images catastrophiques des dévastations superficielles résultant de l’excavation), ne constitue pas le problème environnemental principal selon les experts qui indiquent le rôle extrêmement polluant et beaucoup moins « immédiat » du traitement chimique du minerais.
S’il est intéressant de faire un tour dans les cave qui se cachent comme des blessures honteuses derrière les monts qui entourent Carrare, c’est que cette expérience nous confronte à une situation réelle et non-fantasmée d’exploitation minière étendue au cœur de l’Europe occidentale dans un contexte d’économie capitaliste imbriquée dans l’institution publique et la communication médiatique[14]…
La disparition magique de la montagne sous le marbre
Que l’on arrive dans la provincia de Carrare par le nord ou par le sud, que l’on vienne de la mer ou de l’arrière-pays, le regard croise forcément les Alpes Apuanes, des montagnes acérées à quelques kilomètres de la mer, le plus souvent méconnues malgré un écosystème d’une richesse unique, labellisé par l’UNESCO. Ces montagnes sont merveilleuses et fragiles parce qu’elles sont karstiques : creusées, pleines de trous et de blessures, parfois abattues, dévorées de l’intérieur pour en extraire le marbre et le réduire en poussière. Un entrelacement de beauté et de dévastation qui leur a valu une place privilégiée dans la sélection du documentaire Anthropocène. The Human Epoch (2018), un voyage à travers 43 des plus importantes catastrophes environnementales du monde.
Le manque de réputation de l’environnement des Alpes Apuanes est contrasté par la réputation mondiale du marbre qui y est produit, dans une situation où de la complexité vivante du « fond » historique, social et environnemental de cette région, ne reste que la « figure » économiquement extraite d’une matière productive[15]. Ici nous rencontrons déjà un paradoxe crucial, compréhensible comme un résultat de ce que nous pourrions appeler la « sorcellerie capitaliste[16] ». Nous sommes au niveau du langage et la sorcellerie a souvent affaire aux formules langagières et leur pouvoir magique, performatif. Si nous regardons de près, ce que nous connaissons sous le nom de « marbre » est avant tout une « montagne », le résultat géologique et biologique d’un processus de dizaines de millions d’années, que notre voracité nous permet de détruire aujourd’hui à une vitesse incroyable.
Un geste langagier entraîne une marchandisation, ou vice versa : peu importe. Les mots, en tout cas, comptent – ils comptent l’argent que les grands entrepreneurs encaissent. En se promenant dans ces lieux, on entend une sorte de mantra répété en chœur par ces derniers, accompagnés par les hommes politiques et une population « captive » : « Carrara est le marbre et le marbre est Carrara ». Il est bien connu que Carrare est une ville, composée de personnes, entourée de montagnes, traversée par un torrent furieux, baignée par la mer ; et le marbre n’est qu’un type particulier de pierre, aujourd’hui facilement rentabilisable.
Une rentabilité principalement privée et élitaire, qui ne ruisselle point, mais paradoxalement appauvrit : depuis que l’activité minière et le chiffre d’affaires des entreprises ont augmenté de façon exponentielle par leur déploiement à une échelle intensive et ultra-appareillée, le chômage et la pauvreté, ainsi que les coûts environnementaux et sanitaires, n’ont fait que croître. Les cave carrarine représentent un emblème parfait de ce qu’Alexandre Monnin appelle une « ruina ruinans », c’est-à-dire une forme d’exploitation parfaitement vivante et fonctionnelle qui ne cesse de ruiner ce qui l’entoure par son propre fonctionnement[17].
Ce qui se cache derrière l’art-washing…
Sur le plan de l’économie et de l’emploi, nous assistons à une des apories classiques de la dynamique extractive dans le capitalisme tardif et mondialisé : un département avec un taux de chômage supérieur à la moyenne toscane (région notoirement aisée) et avec seulement environ 1 % de la population employée dans l’industrie du marbre, qui voit très peu d’entrepreneurs augmenter leur chiffre d’affaires (et leurs bénéfices) contre une diminution constante des emplois et une population provinciale de plus en plus pauvre[18]. En 1994, il y avait environ 3 000 travailleurs, alors qu’aujourd’hui il y en a environ 1 700.
Aux côtés d’entreprises avec 11 employés et des bénéfices de presque 14 millions d’euros (40 % du chiffre d’affaires), nous retrouvons des municipalités qui, malgré les importants revenus versés par les entrepreneurs du secteur minier, sont endettées en raison des coûts indirects de la monoculture de marbre (infrastructures comme la « route du marbre » construite avec l’argent public, coûts de l’instabilité hydrogéologique, coûts sanitaires, incapacité à diversifier l’économie). Bien sûr, les 2 000 cavisti ne meurent pas de faim, mais trop souvent ils meurent au travail. Sur la période 2015-2019 ont été enregistrés sept décès. Quant aux accidents, y compris graves, de 2005 à 2015, l’agence de santé locale (ASL) en a enregistré 1 258.
Ces dégâts sont refoulés derrière le voile des représentations : en se cachant sans vergogne derrière l’image glorieuse de l’art de Michel-Ange (aujourd’hui, seulement 0,5 % du marbre est destiné au secteur artistique), au moins 80 % des montagnes sont aujourd’hui détruites pour fabriquer de la poudre, du carbonate de calcium pour les grandes industries (dentifrice, colles, cosmétiques, abrasifs…). Derrière cet art-washing[19], deux productions ont été privilégiées : le bloc, qui est vendu en une seule pièce à de riches acheteurs étrangers puis transformé à l’étranger, et le carbonate de calcium, qui est transformé en poudre principalement par les multinationales Omya et Imerys.
Alors que les détritus posaient autrefois problème parce qu’ils n’étaient que des déchets, aujourd’hui même la poussière de marbre a son propre marché. Ainsi, pour maintenir les niveaux de productivité, même si les emplois diminuent, il faut détruire de plus en plus. Les processus de transformation intermédiaire sur place disparaissent et les studios d’art luttent pour récupérer le matériel que les entrepreneurs préfèrent vendre ailleurs. Un scénario loin d’être candide, celui du célèbre marbre de Carrare[20].
En ce qui concerne l’environnement, il est prouvé que l’extraction du marbre d’Apuane détruit l’un des systèmes karstiques les plus fragiles et uniques d’Europe et entraîne la pollution du bassin hydrographique le plus important de Toscane, alors que les coûts des filtres spéciaux pour l’eau potable de la province sont supportés par les citoyens. La richesse de la biodiversité végétale – 30 % de la flore italienne avec une vingtaine d’espèces endémiques[21] – est en danger à cause du changement climatique et de l’exploitation minière (deux complices…). Cette dernière a également été un facteur déterminant dans les différentes inondations qui ont frappé Carrare au cours des vingt dernières années – avec la mort d’une femme en 2003 et des millions d’euros de dégâts – tant à cause de la cimentation et du rehaussement du lit des rivières dus aux déchets miniers collatéraux (« marmettola »), que de la modification substantielle des crêtes des montagnes.
Une poupée russe extractiviste
En se promenant dans le centre historique de Carrare, on a l’impression de se trouver dans un endroit qui vient d’être frappé par un tremblement de terre. Malgré l’absence de décombres, nous y retrouvons le même air de vide et de suspension. Il y a des panneaux « à louer » et « à vendre » partout, des bâtiments d’apparence noble aux fenêtres fermées et au plâtre écaillé, très peu de gens dans les rues, un rythme lent, presque immobile, qui semble venir d’une autre époque. Beaucoup de gens disent que « c’est la faute de la politique », de son plan raté pour « touristiser » le centre, comme cela s’est produit dans les villes voisines, devenues pôles d’art et d’histoires mondialement connues (Florence, Pise, Lucca…).
Pour un public français, la situation d’une ville comme Saint-Étienne sera peut-être un exemple plus familier et relativement comparable d’une ville minière connaissant une tentative (pas si concluante, pour l’instant) de conversion en site touristique, en récupérant de son expérience industrielle le label rentable du « design »[22]. Dans les contrées européennes en voie de désindustrialisation, donc en Italie comme en France, le projet du tourisme de masse (qui a été empruntée par presque toutes les villes transalpines) apparaît comme une des stratégies principales pour tirer profit des territoires à l’échelle internationale.
Malgré une différence superficielle, la logique profonde de cette dynamique ne diffère pas tellement des écosystèmes d’exploitation comme celui agroindustriel ou minier : c’est celui d’une monoculture d’extraction de valeur marchande qui concerne de moins en moins le territoire et ses citoyens, et de plus en plus un petit groupe d’entrepreneurs millionnaires qui cotent leurs entreprises en bourse. La monoculture touristique doit être considérée comme une nouvelle déclinaison d’extractivisme mettant en danger des environnements vivants (socio-culturels et économiques, notamment) dont l’accélération contemporaine doit beaucoup à sa numérisation, comme le démontre le rôle bien connu d’Airbnb.
L’écosystème du capitalisme extractiviste n’isole pas les différents régimes d’exploitation, au contraire il les raccorde dans un réseau d’interdépendances : l’extraction de valeur touristique demande de plus en plus l’intermédiation digitale (app, données, captation attentionnelle…) qui inspire (comme l’a affirmé candidement Barbara Pompili) de nouvelles exploitations « riveraines » du sous-sol. La boucle est bouclée, elle n’arrête de se boucler comme une spirale qui tourne en creusant son gouffre dans le sol sur lequel nous nous tenons…
