La candidature Pécresse : anatomie d’un naufrage
À l’instar du score famélique reçu par Les Républicains lors des élections européennes de 2019, personne ne s’attendait à ce que la candidature de Valérie Pécresse ne finisse aussi bas. Certes, les espoirs étaient déjà éteints depuis plusieurs semaines, après l’ouverture d’une étroite fenêtre sondagière au début de l’année 2022, mais les 4,78% obtenus – divisant par 4 le score arraché par François Fillon en 2017 – sonnent davantage comme un naufrage, voire comme un cataclysme, que comme une simple défaite.
À l’issue de ce scrutin, la droite de gouvernement héritière des fondateurs de la Ve République se retrouve a priori pour la troisième fois consécutive exclue de l’exercice du pouvoir exécutif et ne semble plus rien représenter de concret au sein de l’électorat français. Siphonnée par ses voisins idéologiques à sa gauche et à sa droite, rien ne laisse présager un destin autre que marginal au sein du système politique national. Il apparaît donc légitime de chercher à expliquer ce phénomène et nécessaire pour cela de ne pas être aveuglé par les cahots évènementiels qui ont agité la campagne de la candidate LR.
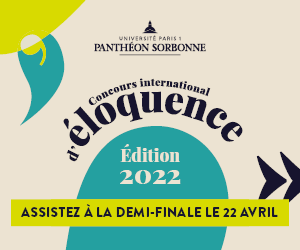
Panorama électoral de la droite en 2022
Dans l’ensemble, les facteurs explicatifs du vote Pécresse sont sensiblement les mêmes que pour celui du vote Fillon. Si l’on s’en tient aux données proposées par Ipsos-Sopra Steria sur la sociologie des électorats du premier tour, la candidate a essentiellement surperformé chez les 70 ans et plus (12 %) et les retraités, chez les catholiques pratiquants réguliers (13 %) et occasionnels (9 %) dont on sait qu’ils sont souvent plus âgés que la moyenne, et chez ceux qui se disent appartenir aux milieux aisés ou privilégiés (10 %).
Au contraire, elle sous-performe nettement chez les électeurs de moins de 60 ans (2 à 3 %), chez les ouvriers et employés (2 %), chez les salariés du public (2 %) et les chômeurs (1 %), chez les personnes appartenant à un foyer gagnant moins de 2000€ par mois (2 à 3 %), dans les communes
