Comment Kyiv n’est pas tombée
Le 24 février, Vladimir Poutine lançait une attaque coordonnée sur l’ensemble du territoire ukrainien, sous prétexte d’une « opération spéciale ». Cette invasion intervenait après une montée graduelle de la menace depuis l’encerclement de l’Ukraine au printemps 2021 au prétexte d’exercices militaires, et consécutive à l’enlisement du conflit dans le Donbass, ainsi qu’au blocage des accords de Minsk, renégociés en février 2015.
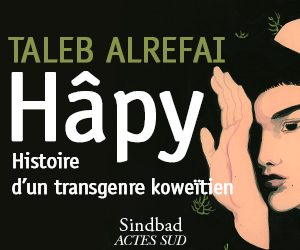
Cette invasion est à réinscrire dans le contexte d’une absence d’issue à la guerre dans l’Est selon les termes de la Russie – soit la tenue d’élections avant une démilitarisation de la région, tandis que l’Ukraine demandait un rétablissement du contrôle de la frontière et la tenue d’élections selon la législation ukrainienne – et l’incapacité du pouvoir russe d’empêcher un processus de rapprochement de l’Ukraine avec l’Union Européenne et l’OTAN initié depuis le moment révolutionnaire « Maidan » de l’hiver 2013-2014.
Si le pouvoir russe ne s’attendait pas à une telle résistance, aussi bien militaire que de la part de la population, cette stratégie se fondait sur l’idée d’un pouvoir affaibli et en (ouvre un nouvel ongperte de légitimité, un manque de centralisation du pouvoir, la fatigue de l’armée ukrainienne après plusieurs années de guerre dans l’Est et l’essoufflement de la vague patriotique.
Après avoir lancé des frappes simultanées, détruisant les axes de communications, les aéroports, les entrepôts militaires, les troupes russes entraient dans la région de Kyiv avec l’objectif d’occuper la capitale et d’assassiner le président en 48/72h, avant d’être stoppées à une trentaine de kilomètres de celle-ci. Malgré les tentatives d’encerclement et d’isolement de la capitale, en essayant de couper l’eau chaude et le chauffage, les axes de communication (antennes de télévision, internet) par des frappes ciblées dans la ville, les troupes russes se retiraient début avril sous prétexte de vouloir concentrer leurs efforts sur le Donbass,
