« Méga-bassines » : aux sources d’un conflit pour l’eau
Avec la lumière et le sol, l’eau est la principale ressource des plantes. L’agriculture dépend ainsi, pour sa croissance, de la présence de la juste quantité d’eau. Depuis la naissance des sociétés agraires, certains cultivateurs, aux endroits ou périodes où la pluie tombe insuffisamment, vont la chercher dans le milieu naturel : ils irriguent.
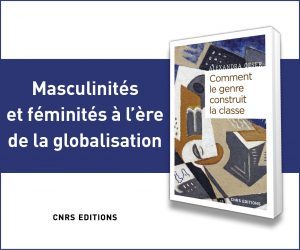
Mais voilà, certains bassins versants français disposent de ressources structurellement incapables de satisfaire tous les besoins. On parle de « zones de répartition des eaux ». Parmi eux, l’ex-région Poitou-Charentes. Les volumes d’eau prélevables pour l’irrigation y ont été drastiquement réduits en 2013 (de l’ordre parfois de 50 %), tandis que des arrêtés préfectoraux de crise paralysent, presque chaque année maintenant, les ponctions en période d’étiage des nappes et des cours d’eau. Frappées par ces restrictions, les exploitations irrigantes du territoire, réunies au sein de coopératives de l’eau, ont voulu sécuriser leur accès à la ressource en portant des projets d’ouvrages de stockage : les fameuses bassines !
Pourquoi des bassines ?
L’idée est en apparence frappée au coin du bon sens paysan : retenir une partie de l’eau qui tombe en abondance l’hiver et qui irait rejoindre la mer ; la conserver pour arroser les cultures en saison estivale ; du coup, puiser moins dans le milieu quand celui-ci est en tension. C’est le principe de la substitution des prélèvements. Selon le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), « une réserve dite de substitution a pour objet de remplacer des prélèvements d’étiage par des prélèvements en période de hautes eaux. Sa conception la rend impérativement étanche et déconnectée du milieu naturel en période d’étiage ». La fonction de la substitution se veut double : soulager les nappes phréatiques l’été, et libérer des volumes estivaux au profit des irrigants qui ne bénéficieront pas de l’eau mise en réserves.
On prendra l’exemple du b
