Traces – pour une psychanalyse à venir
«Traces » est un vocable – il y en aurait d’autres – qui offre la chance de penser la relance, urgente, de la psychanalyse. Cette psychanalyse-là que, depuis quelques années, je n’appelle jamais autrement que psychanalyse à venir. La lier strictement, dans la lettre de son nom, la psychanalyse, à l’à venir, est une façon de la distinguer aussi radicalement que possible de tous les discours réactionnaires contemporains, discours que l’on se permet de tenir en son nom bien souvent et qui, à chaque fois que c’est le cas, m’affligent. Ainsi, lui donner ce nom signifie toujours en même temps qu’une psychanalyse décliniste ou réactionnaire n’a jamais rien à voir avec ce que c’est que la psychanalyse, et ce depuis avant même sa date de naissance officielle. Je reviendrai à sa préhistoire, car Freud y aura tout de suite investi beaucoup et, par là même, y aura laissé des traces précieuses qui ne demandent qu’à être revivifiées – c’est précisément cela une trace mnésique. Immédiatement un branchement s’impose entre « traces » et « à venir ».
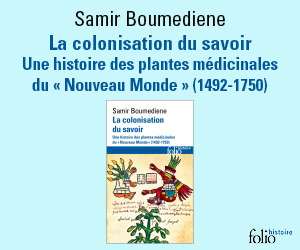
« Traces » n’est jamais le nom de je ne sais quel tropisme pour ce qui fût, de je ne sais quelle nostalgie, attachement viscéral au passé, et de je sais trop bien quelle pulsion réactionnaire non plus. Traces, au contraire, ouvre la venue de ce qui vient dans la rencontre, de ce qui travaille du passé dans le présent, de ce qui hante et meut ce présent qui, ainsi habité n’est ou ne peut jamais être pur présent. On aurait raison de penser là et au travail incontournable de Georges Didi-Huberman avec les « survivances » de Warburg – entre autres – et à la grande et révolutionnaire notion d’après-coup conçue par Freud, car, comme son nom l’indique, après-coup, c’est déjà l’à venir.
La seule écoute possible se fait depuis le non-savoir de la venue de ce qui vient.
À venir signifie non pas simplement futur, mais ce qui vient, à savoir la venue du venir et donc ouverture par ce qui surgit, effracte, disrupte, arrive. Une psychanalyse
