Le financement du terrorisme via le versement de rançons
Le 5 mai 2021, le journaliste français Olivier Dubois a annoncé avoir été kidnappé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Le 13 mars 2022, dans une vidéo non authentifiée, il a demandé au gouvernement français de « continuer à faire son possible » pour sa libération. Depuis le début de l’enlèvement, le quai d’Orsay est resté silencieux, assurant qu’en ce domaine « la discrétion est une condition essentielle de l’efficacité de l’action de l’État ». Dans le respect des exigences de confidentialité qui s’imposent effectivement dans le cadre du traitement de cet enlèvement, cet article a pour objet d’exposer la façon dont procède traditionnellement la France lorsqu’elle est confrontée à ce type de situation.
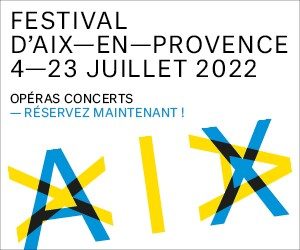
Depuis le début du XXIe siècle, les enlèvements contre rançon prospèrent dans des régions où l’État peine à affirmer son autorité à la suite d’interventions militaires extérieures (Irak, Syrie, Sahel…). La déstabilisation politique provoquée par ces interventions favorise l’essor de groupes autonomes qui prennent le contrôle politique et militaire de ces régions. En raison des actes dont ils sont responsables (destructions massives, enlèvements, atteintes à l’intégrité physique des personnes), certains d’entre eux sont inscrits sur la liste des organisations terroristes établies par un Comité du Conseil de sécurité des Nations unies. L’inscription sur ces listes permet, en particulier, de lutter contre le financement de ces organisations en gelant leurs avoirs. Afin de continuer à se financer, les organisations concernées sont obligées de contourner ces mesures en privilégiant des activités permettant de récolter de l’argent liquide.
Sans être étayée par des preuves formelles, la duplicité de la position française est largement relayée par les médias.
Aux côtés des appels au don et du racket, l’enlèvement contre rançon devient, pour reprendre les termes d’un cadre de l’une de ces organis
