Changer de cosmologie ou refaire du socialisme ?
Alors que les débats sur l’union de la gauche retrouvent une certaine actualité dans le monde politique, l’une de ses principales dimensions, le renouvellement de la pensée socialiste classique par les enjeux écologiques, demande encore à être théoriquement clarifié. Les réflexions sur la question sont nombreuses et dynamiques, mais c’est en repartant d’un petit texte à vocation politique récemment paru qu’on peut aborder de front ces enjeux, car on y trouve poussées à leur terme certaines logiques de l’œuvre de l’un des principaux théoriciens de l’écologie politique contemporaine. C’est dans le contexte des dernières échéances électorales présidentielles que Bruno Latour et Nikolaj Schultz, l’un de ses doctorants travaillant sur les classes « géo-sociales », ont tenté, avec leur Mémo sur la nouvelle classe écologique, de construire le cadre d’une réelle politisation de l’écologie.
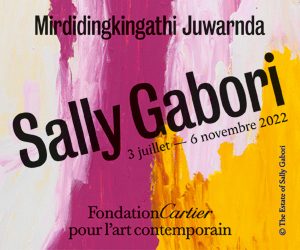
Cette ambition résulte d’un constat, évident quoi que rarement énoncé avec une telle clarté, relatif au paradoxe dans lequel s’est enferré l’écologie politique : elle constitue un arrière-plan commun à tous les projets progressistes, et une référence obligée des autres, tout en se trouvant absolument incapable de s’imposer comme l’enjeu décisif autour duquel les mobilisations populaires et les projets politiques s’articuleraient. Quelque chose manque donc à l’écologie, qui malgré ce contexte favorable « réussit l’exploit de faire paniquer les esprits et de les faire bailler d’ennui » (p. 46). C’est en prenant au sérieux ce paradoxe que les deux auteurs sont conduits à développer un diagnostic général de la politique contemporaine, sous la forme de ce court opuscule dont l’objectif revendiqué est de sortir l’écologie politique de sa paralysie.
Davantage manifeste qu’essai, ce texte s’adresse surtout aux responsables des partis écologistes, qui, d’après les auteurs, ont jusqu’à présent failli à la mission qui leur incombe : créer une dynamique d’identification et de mobilisation à
