Le merveilleux colonial – à propos de la 59e Biennale d’art de Venise
J’ai visité avec ma fille la 59e Biennale de Venise durant les jours de juin les plus étouffants. La pandémie n’a pu reporter cet événement disproportionné et mégalomane, qui se répète depuis 1895, que d’un an seulement. Au fil des ans, la Biennale a abandonné le modèle des salons et, avec l’adjonction des pavillons nationaux, s’est transformée en une exposition artistique universelle à proprement parler.
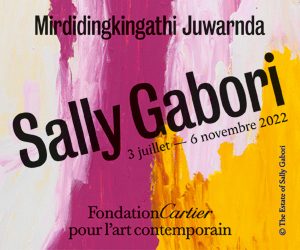
À l’exemple des Great Exhibitions de l’ère victorienne, les pavillons nationaux des puissances coloniales européennes – d’abord la Belgique (1907), puis la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Hongrie depuis 1909, la France et la Suisse depuis 1912 – se bravaient dans les jardins de Venise à coups d’innovations esthétiques et d’universalismes culturels. Aujourd’hui encore la Biennale ne sort pas du champ de l’internationalisme et du nationalisme ; elle s’articule à travers une exposition internationale centrale et des représentations diplomatiques et étatiques autonomes de l’art national.
Tous les deux ans, la mission assignée aux curateurs est de capturer et de mettre en scène, dans cette putrescente et sublime ville-musée, rien de moins que l’esprit du temps, de le canaliser dans les divers lieux d’exposition de la Biennale, démontrant autant la vitalité sauvage de l’art que la capacité de domestication exercée à l’échelle mondiale par cette institution. Pour autant que les artistes cherchent à se soustraire aux présupposés idéologiques de cette exposition universelle, la Biennale reste un zoo de l’art contemporain, un freak show d’étranges créatures esthétiques arrachées à leur contexte culturel, transportées d’un continent à l’autre et enfermées dans les Pavillons. Comme un visiteur de jardins zoologiques, j’ai erré entre les artefacts de la Biennale, étranges objets tantôt féroces et terrifiants tantôt dociles et émouvants. Les pages qui suivent sont un compte rendu de cette expérience déconcertante.
Hybrides et métamorphoses
Cecilia Alemani, première
