Le capitalisme est-il contradictoire ? Joan Robinson face au marxisme
Pour comprendre ce qui a amené Joan Robinson, fondatrice avec d’autres du courant post-keynésien, à écrire en 1942 son incisif Essai sur l’économie de Marx, il faut remonter aux années qui précèdent. À la fin des années 1930, elle se trouve dans une position ambiguë vis-à-vis du marxisme. D’une part, ce courant produit une critique du capitalisme qui lui convient, et l’esquisse d’une réorganisation économique fondamentale à laquelle elle est ouverte ; mais d’autre part, elle est sceptique vis-à-vis du « jargon », comme elle l’appelle, des marxistes et de certaines de leurs hypothèses économiques. C’est cette ambivalence qu’elle cherche à tirer au clair dans les années qui suivent.
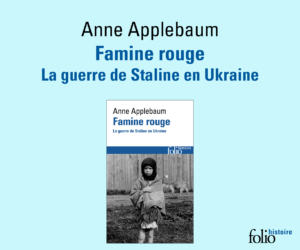
Elle entame le dialogue avec les socialistes, que ce soit ses étudiants ou Maurice Dobb, son collègue à Cambridge, économiste marxiste et membre actif du Parti communiste britannique. L’élucidation analytique bute pourtant sur la question du langage. Sa formation économique, et celle de ses collègues, s’est faite dans les catégories néoclassiques de Marshall ; elle utilise aussi désormais les nouvelles catégories keynésiennes qu’elle a contribué à construire. Mais les socialistes parlent une autre langue encore, celle de Marx.
Traduire Le Capital
Comme pour accompagner sa propre lecture du Capital, elle développe donc ce qu’elle présente à son ami et collègue Richard Kahn comme un projet de dictionnaire :
« Mon prochain projet est de faire à Marx un dictionnaire, pour qu’il puisse être lu par les économistes. Valeur = heures de travail. Survaleur = produit – salaires réels, etc[1]. »
Tel est donc le projet de Joan Robinson : traduire Le Capital dans des termes, des catégories qui ne sont pas les siennes. En un certain sens, ce projet n’est pas nouveau, et on peut le replacer dans la succession des tentatives de clarification analytique, souvent de formalisation du système de Marx, tentatives qui ont toujours mis en lumière, bien que sous des angles différents, les mêmes problèmes
