Homme rétréci, humanité grandie – sur The incredible shrinking man de Jack Arnold
C’est une impression intermittente mais assez pénible que de se sentir rétrécir entre les quatre murs du confinement, alors que le monde se dilate à la démesure de la pandémie, ou bien rapetisse-t-il aussi d’être assigné à penser sa finitude, la mort, et toute cette sorte de choses. Cette perte d’échelle est-elle un des troubles de l’intellection et du sensoriel qu’observent les cliniciens chez les gens livrés au vertige existentiel de la réclusion ? Le fait est qu’en cette occasion, L’homme qui rétrécit offre une occasion royale de se remettre d’aplomb.
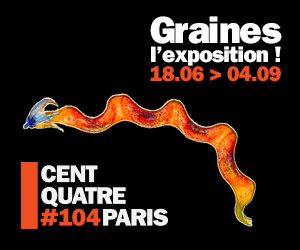
Un champignon de nuage grossit à l’horizon du générique, puis nous surfons sur des vagues, de l’écume, enfin une voix nous parle, et c’est rassurant. Un homme est allongé au soleil sur son bateau, c’est lui que nous entendons, ou plutôt sa voix intérieure, convention narrative, tout va bien. Rien ne va du tout. Cette voix provient du paysage d’océan, des vagues, du ciel, du vent, d’un espace non localisé, d’un passé ou d’un futur indéfini, autant dire de nulle part concevable.
L’histoire est connue : contaminé par un nuage toxique lors d’une sortie en mer, Scott Carey se met à rapetisser sans recours, sans fin, proprement sans fin, géniale idée du film qu’il n’ait pas de fin sinon dans ce qui s’annonce dès la première image : eau et ciel originels qui sont notre milieu naturel, notre histoire.
Le prologue présente un jeune couple conforme à la plastique des années 50, tous deux beaux et blonds, sagement occupés au bronzage, Louise en short et tee-shirt, Scott en maillot de bain, mais guère d’érotisme dans cette semi-nudité. Plutôt copains qu’amants dans la gestuelle sans élan, le babil vacancier, bisou rapide concluant le simulacre en mineur d’une scène conjugale : qui ira chercher de la bière dans la cabine ?
Le scénario exigeant que Louise soit à l’abri quand déferle le fatal nuage, elle cède ; contre la promesse que Scott prépare le dîner. Inversion des rôles qui, pour l’Américain de l’époque, trouble
