Le retour en grâce du syndicalisme américain
À la fin du mois de mars 2022, les travailleurs de l’entrepôt Amazon de Staten Island, à New York, votaient pour créer le premier syndicat de l’histoire de cette entreprise. Au même moment, à Bessemer, dans l’Alabama, les travailleurs d’un autre entrepôt votaient derechef – le premier scrutin, l’année précédente, avait été annulé, les agences publiques du travail jugeant que l’entreprise avait enfreint les règles. Ces David faisant face au Goliath de la mondialisation numérique ont suscité les espoirs de tous ceux qui, dans le monde, aspirent à une revitalisation syndicale. Or, ces élections s’inscrivent dans un contexte bien différent.
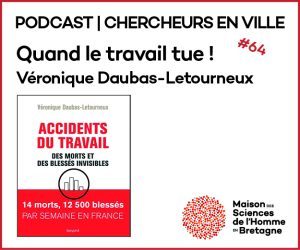
Dans plusieurs secteurs et sous différentes formes, les travailleurs américains sont engagés dans des mouvements qui révèlent les réalités d’un marché du travail fragmenté, et d’un système de relations professionnelles qui leur est défavorable. Déclenchée par les employés des cafés Starbucks, une véritable vague de syndicalisation s’est répandue parmi les travailleurs à bas salaire du secteur des services, en première ligne pendant la pandémie de Covid-19. D’autres secteurs du tertiaire ont, eux, été touchés par une multiplication de départs et de changements d’emploi, phénomène sans précédent baptisé désormais la « Grande démission ». Quant au secteur de la production, bastion du syndicalisme traditionnel, il a vu éclater en 2021 un très grand nombre de mouvements de grève. Le pic d’octobre (plus de 100 000 grévistes) a donné naissance à un néologisme : « Striketober » (contraction de strike, grève, et October).
Si les revendications des travailleurs ne datent pas d’hier, celles qui ont été portées lors de ces événements ont pour origine la dégradation des conditions de travail et de rémunération pendant la crise du Covid. La conjoncture met tout particulièrement en évidence la spécificité du modèle des relations d’emploi aux États-Unis. Plus que dans d’autres pays développés, les conditions de travail et de rémunération a
