L’exposome ou les risques d’une science des données environnementales
Dans les sciences de la santé, le concept d’exposome désigne depuis le milieu des années 2000 l’ensemble des expositions environnementales auxquelles sont soumis les individus de la conception jusqu’à la fin de la vie. En choisissant un terme qui fait écho au génome, les promoteurs de l’exposome entendaient améliorer l’évaluation du rôle des facteurs environnementaux dans le développement de certaines pathologies (asthme, maladies cardiovasculaires, cancers, etc.) et encourager, par la suite, la mise en place de stratégies de prévention plus efficaces.
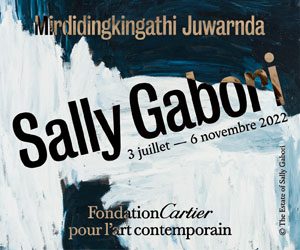
Cependant, la définition très large de l’exposome et les outils qui permettent de le mesurer – technologies dites « -omiques », applications de téléphones portables, etc. – laissent planer la menace d’une accumulation de données qui pourraient être utilisées pour disqualifier a priori les individus dont l’exposome serait jugé défavorable, et limiter ainsi leurs opportunités en termes d’accès à certains services, voire à certains emplois. La question est alors de savoir si la science de l’exposome ne risque pas de préparer malgré elle un « Gattaca environnemental », à savoir un univers où les données environnementales pourraient venir alimenter une activité de profilage potentiellement liberticide.
L’exposome, un coup de projecteur sur le rôle de l’environnement dans la santé et la maladie
Le concept d’exposome a été estampillé en 2005 par Christopher Wild. À travers ce terme, l’épidémiologiste spécialiste du cancer souhaitait mettre en lumière le rôle des expositions environnementales dans le développement de certaines pathologies. Plus généralement, l’objectif des promoteurs du concept d’exposome était d’encourager une évaluation exhaustive et de longue durée des expositions environnementales pathogènes. Il s’agissait pour eux de dépasser les limites explicatives des études consacrées à un seul facteur environnemental – par exemple la pollution de l’air – et des recherches centrées sur le génome[1].
Le mot
