Liberté éthique ou liberté métaphysique ?
L’éthique a-t-elle besoin d’un fondement métaphysique ?
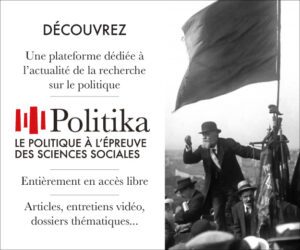
C’est ce que les philosophes ont soutenu pendant près de 1 300 ans, entre Boèce (mort en 524) et Kant. Au XIIIe siècle, Thomas d’Aquin affirme que, s’il n’existe pas de libre arbitre, c’est toute l’éthique qui s’effondre ; en effet, toute philosophie morale suppose une évaluation de notre mérite ou démérite, donc de notre responsabilité, et si nous n’avons pas eu la capacité d’agir autrement, sans libre arbitre, nous ne sommes pas responsables de nos actions. Kant, en proclamant dans la Critique de la Raison Pratique que la liberté est un postulat de la raison pratique, ne dit pas autre chose.
Et pourtant, le concept de libre arbitre nous conduit dans une contradiction, que Kant lui-même a décrite dans la Critique de la Raison Pure : soit nous maintenons le principe de raison suffisante (il n’y a pas d’effet sans une cause ou raison qui suffit à l’expliquer), soit nous devons admettre que la liberté de l’homme fait exception à ce principe de déterminisme universel. La question devient alors : comment admettre une action libre, une capacité d’agir autrement, si l’on admet que tous les phénomènes sont soumis à une causalité nécessaire ?
Telle est l’aporie sur laquelle nous avons longtemps vécu. La métaphysique antique et médiévale a construit notre problématique. Elle n’a d’ailleurs n’a pas simplement fondé les analyses philosophiques ; sans que nous en ayons conscience, elle se retrouve dans certaines de nos représentations les plus courantes, et même dans nos langues. Il n’est pas anodin que le concept de « libre arbitre » se dise en anglais free will : c’est déjà supposer que la liberté réside dans la volonté. Cela veut dire que nos langues véhiculent une certaine interprétation du problème : ici, en l’occurrence, placer la liberté dans la volonté, et éliminer les explications alternatives.
Mais est-ce bien ainsi qu’il faut poser le problème ? Sommes-nous condamnés à répéter éternellement les mêmes p
