De l’Europe et du climat
Les Européens sont à jour de la menace. Dans un Eurobaromètre spécial de 2021[1], le changement climatique est considéré par les citoyens de l’Union européenne comme le problème mondial le plus grave. La pauvreté et les maladies infectieuses le suivent de près parmi les options proposées, lesquelles distancent les enjeux de sécurité (terrorisme, conflits armés, prolifération nucléaire), relégués en bas de tableau. Les limites des sondages sont connues, et 2022 présentera sûrement une configuration différente. Mais on ne saurait nier le problème social posé par cet esprit européen actuel.
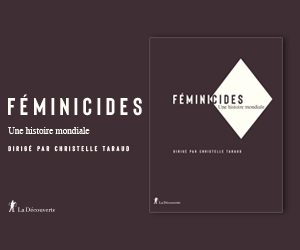
Cet état de conscience n’est pas la nouveauté que l’on croit. Le climat n’est pas une menace documentée propulsée dans l’opinion par les évaluations successives du GIEC. Il n’est pas qu’une tendance « années 2020 » ou même prospective. Il a la part de l’ancêtre. La conscience européenne doit beaucoup au climat. À certains égards, elle en est issue.
L’Europe contemporaine est en partie fondée sur l’attention portée au changement climatique. Et inversement, l’effet de serre est une conception originellement européenne – peut-être son produit d’exportation le plus couru. Les Européens et le changement climatique se sont entre-fabriqués, de manière non-linéaire. Il est possible que nous arrivions à un nouveau moment européen, alors que des législations climatiques emblématiques sont en passe d’entrer en vigueur. Il ne s’agit peut-être d’une étape nouvelle de définition de l’identité des Européens.
L’Europe est désormais bien identifiée sur la carte internationale des méga-feux comme celle des inondations meurtrières. Le continent est un haut-lieu de l’ère des conséquences du réchauffement climatique. Chaque année, des citoyens grecs comme suédois sont poursuivis par les flammes, et on suffoque « de l’Atlantique à l’Oural ». La conscience du réchauffement climatique y semble aujourd’hui majoritairement acquise. Mais l’idée d’une prise de conscience des enjeux climatiques n’a ri
