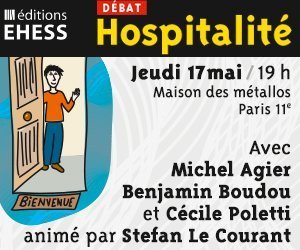Black bloc : le mot, la chose, la représentation
Ce qui s’est déroulé le 1er mai dernier aux alentours du pont d’Austerlitz à Paris ne porte le nom de « black bloc » que sous conditions. Il est des cortèges cagoulés, qui, par le passé, furent qualifiés différemment — le défilé du collectif étasunien Black Mask Group dans les rues de Wall Street au mois de février 1967 est rarement décrit comme tel[1]. Assurément, il est des rassemblements émaillés ou non d’actions violentes qui, dans le futur, draineront d’autres qualificatifs. Pour l’heure, et depuis près de quatre décennies, le black bloc est le nom consacré d’une esthétique du politique construite à même l’espace urbain : apparaître cagoulé et vêtu de noir le temps d’une manifestation. Définition qui ne néglige ni la réalité matérielle des institutions combattues, ni l’expérience vécue des pratiques militantes. Il s’agit d’une représentation (en son sens verbal et visuel) critique de la représentation (en son sens politique). Un conflit des représentations. Une image des temps.
Cette définition n’est pas unique en son genre. D’autres descriptions s’attachent à ne pas séparer les sphères du politique et de l’esthétique. « Un black bloc est un vaste drapeau noir tissé de corps et qui flotte au cœur d’une manifestation[2] », écrit le politiste et militant anarchiste québécois Francis Dupuis-Déri. Le tissu noir, un temps brandi, est aujourd’hui porté à même les corps afin de garantir l’anonymat militant, faisant aussi du black bloc une histoire de la manifestation de rue à lui tout seul. Durant les années 1980, précise pour sa part le politiste George Katsiaficas, « les drapeaux noirs ou les vestes en cuir noir portées par de nombreux manifestants étaient moins le signe d’un anarchisme idéologique qu’un style vestimentaire et une attitude […]. Le noir devint la couleur d’un vide politique — du retrait de toute allégeance envers un parti, un gouvernement ou une nation[3]. »
Dès l’origine, le black bloc est une chose déformée par les mots : un stigmate dés