Rwanda, de la responsabilité française
Le 16 mai 1994, sur le plateau du 20h de TF1, Jean-Hervé Bradol, responsable des programmes de Médecin sans frontières France au Rwanda, de retour de Kigali, met violemment en cause le rôle de Paris dans le génocide en cours. Face à un Patrick Poivre d’Arvor impassible, il lance avec gravité : « Le rôle de la France dans ce pays et les responsabilités de la France sont particulièrement écrasants. Les gens qui massacrent aujourd’hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée et systématique d’extermination sont financés, entraînés et armés par la France […]. On n’a entendu aucun responsable français condamner clairement les auteurs de ces massacres. Et pourtant ces gens sont bien connus de l’État français puisqu’ils sont entraînés et équipés par eux. » [1]
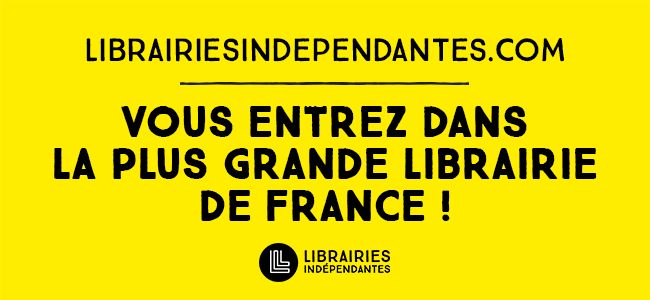
Depuis le 7 avril 1994, ce petit pays alors surtout connu en Europe pour ses coopérants, ses collines verdoyantes et ses gorilles, se trouve plongé dans une vague de violences extrêmes : les Rwandais tutsi y sont exterminés, avec ordre et détermination, par des Forces armées rwandaises secondées par les milices Interahamwe (« ceux qui combattent ensemble ») et par une partie de la population civile hutu. Orchestré par le gouvernement intérimaire rwandais, le « génocide des voisins » vise à l’anéantissement complet des Tutsis du Rwanda.
Présentée comme neutre, strictement humanitaire et à durée limitée, l’Opération Turquoise bénéficie d’une attention médiatique immédiate.
Qualifiés d’Inyenzi (« cafards »), ces derniers sont considérés par les extrémistes comme des « ennemis intérieurs » complices d’un Front patriotique rwandais (FPR) qui revendique par les armes le droit au retour des familles tutsi exilées à la suite des pogroms anti-tutsi de 1959, 1963 et 1973. Après avoir évacué leurs ressortissants durant les premiers jours, Français, Belges et Américains font le choix de rapatrier leurs soldats et de soutenir la résolution 912 du 21 avril 1994 qui réduit le contingent de la mission de l’ONU au Rw
