Le si sexiste universalisme littéraire français
Dans un texte précédent pour AOC, je tachais de signaler que la formation historique de la littérature française – incluant les théories de la littérature, les critères d’appréciation du littéraire (et donc du non-littéraire), les instances et les académies consacrantes, le réseau de fabrication et de diffusion des œuvres ainsi que les œuvres elles-mêmes – était structurée par un imaginaire de la « race [1] ». Ce que Sarah Burnautzki a nommé, avec justesse, « les frontières racialisées de la littérature française [2] ». En cela, la prétention universelle des belles-lettres s’apparente à un régime de représentation victorieux, pourrais-je dire, dont la victoire a précisément résidé en sa capacité à enfouir jusqu’au déni le particularisme sur lequel il se fondait pourtant. En cela, l’universalisme littéraire français – à l’image de tout universel – semble indistinct du fait raciste.
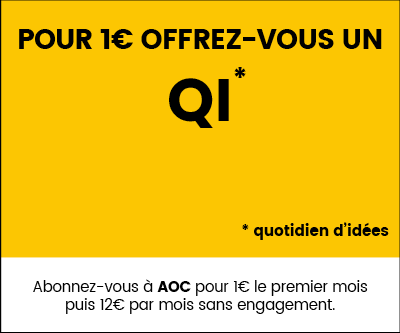 Plus encore, l’universalisme littéraire français autorise le fait raciste car, ainsi, il s’autorise lui-même. Ou, dit d’une autre manière, il se dote de cette autorité d’ériger sa propre loi et de déterminer, pour son propre bénéfice, celles des autres sans eux, c’est-à-dire contre eux.
Plus encore, l’universalisme littéraire français autorise le fait raciste car, ainsi, il s’autorise lui-même. Ou, dit d’une autre manière, il se dote de cette autorité d’ériger sa propre loi et de déterminer, pour son propre bénéfice, celles des autres sans eux, c’est-à-dire contre eux.
Dans ce second texte qui désormais augmente le premier, je souhaiterais préciser qu’au sein du champ littéraire français, aux rapports sociaux de race s’articulent des rapports sociaux de sexe, fondements de la division sexuelle de ce travail qu’est écrire et publier. Parce que s’y diffractent les forces du social, la littérature, champ de tensions perpétuelles entre le dicible et l’indicible, entre ceux qui disent et ceux qui sont dits, entre dire pour ne pas faire et ne pas dire pour faire, est aussi fortement le produit de la hiérarchie des sexes que la productrice de cette dernière. Ainsi, si je veux bien reconnaître à la littérature française un secret, le seul peut-être véritablement secret, lointain de tous les secrets dont on aime à la parer pour mieux se rendre aveugle à ce qu’elle est, ontolo
