Littérature, islamisme, et guerre des langues en Algérie
En cette rentrée 2018, l’apprentissage de la langue arabe fait l’actualité, que l’enjeu soit de développer et renforcer le prestige d’une grande langue de civilisation (pour le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer), ou que l’enjeu soit sécuritaire, la langue arabe étant enseignée en priorité dans des contextes religieux (selon le rapport « La Fabrique de l’islamisme » de Hakim El Karoui). On sait la difficulté de penser en France la place des langues autres que le français. En 2018, la France ne célèbre pas les 20 ans de la mise en application de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires : proposée en 1992 pour une application en 1998, elle n’a été signée par la France qu’en 1999, et n’a toujours pas été ratifiée.
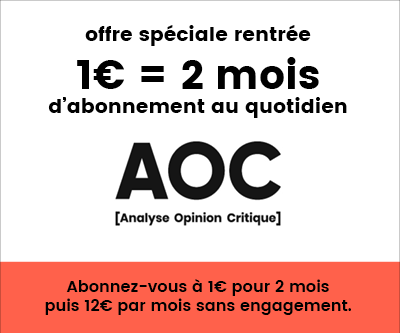
La langue arabe et l’Algérie
La place de la langue arabe est plus complexe encore du fait de l’histoire coloniale. Après la conquête française de l’Algérie et la déstructuration de son enseignement alors florissant, puis sa marginalisation institutionnelle, l’arabe y a été assimilé à une langue étrangère par un arrêté du Conseil d’État en 1935. La stigmatisation de la langue arabe en France a la peau dure, charriant face à la langue française un imaginaire colonial fait d’archaïsme, de fellagha, et de terroriste.
C’est ainsi que la guerre civile algérienne des années 1990 a pu être perçue en France comme une « guerre des langues », opposant arabophones et francophones, ces derniers seuls étant tournés vers la modernité et donc la France. C’est le cas en 1994 dans les toutes premières minutes d’un documentaire hommage à l’écrivain et journaliste Tahar Djaout, assassiné un an auparavant, il y a 25 ans :
« Aujourd’hui dans certains pays, la parole écrite a le pouvoir de dresser les uns contre les autres intellectuels occidentalisés et intégristes musulmans. […] L’Algérie […] Un pays riche de son héritage musulman, mais marqué aussi par son passé de colonie française. Ces dernières années, le conflit entre ces deux cultures
