Transition écologique : faire confiance à la finance ?
Les Climate Finance Days se sont ouverts ce 26 novembre à Paris pour trois jours. Ils réunissent banquiers, investisseurs institutionnels, politiques et experts de tout genre pour avancer sur le dossier du financement de la transition écologique. Le dernier rapport du GIEC paru début octobre est encore venu rappeler l’ampleur et la radicalité des changements à entreprendre. Mais, malgré la multiplication des cris d’alarme, les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui s’étaient stabilisées dans bon nombre de pays occidentaux sont reparties à la hausse ; dans le même temps, espèces animales et végétales et écosystèmes disparaissent toujours plus rapidement [1].
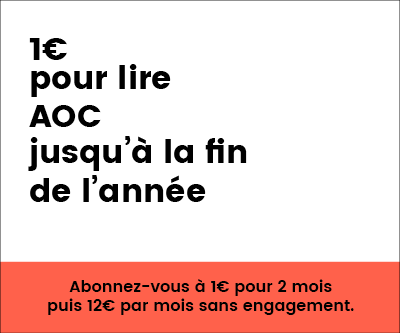
Tandis qu’à l’occasion de la COP 21, à Paris, la grande majorité des pays du monde s’était engagée sur des objectifs de réduction des rejets de GES, les mêmes pays continuent de considérer la croissance économique comme fin unique et ultime. Enfin, alors que le nombre et l’ampleur des crises financières de ces dernières décennies devraient amener à douter de la capacité de la finance à œuvrer pour le bien commun, il est aujourd’hui question de lui confier le financement de la transition écologique.
Ce que l’on espère de la finance dite « verte » : qu’elle capte une petite partie des centaines de trillions de dollars de la sphère financière pour les affecter à la transition du même nom. Il s’agit d’un secteur apparu il y a une dizaine d’années et qui est pour l’instant essentiellement une extension des marchés financiers classiques à des objets « verts ». Comme telle, elle remplit les deux grandes fonctions habituelles de la finance : la couverture des risques et le financement de l’investissement.
La dégradation écologique de la Terre est en effet à l’origine de nouveaux risques. On l’observe de plus en plus fréquemment, le changement climatique engendre inondations, ouragans, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes, événements dont le coût s’alourdit d’année en année. Les ingénieurs financier
