Mexique : un nouveau président face à la violence
Le 14 septembre dernier, dans la périphérie de Guadalajara, la seconde ville du Mexique, les habitants se réveillèrent face à un camion réfrigéré, stationné à la marge de leur quartier. Le semi-remorque, abandonné la veille, ne semblait appartenir à personne. Quelques habitants s’en sont alors prudemment approchés, défiant l’odeur de putréfaction. En ouvrant la remorque, ils trouvèrent 273 cadavres, plus ou moins en décomposition, enveloppés dans des sacs poubelles et entassés les uns sur les autres, du sol au plafond.
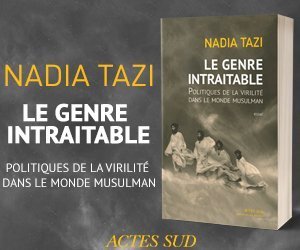
Dans les témoignages rapportés par la presse mexicaine, certains habitants indiquèrent qu’ils étaient habitués à trouver des cadavres autour de leur quartier, laissés là dans l’attente que quelqu’un appelle la police ou une ambulance, pour les embarquer. Mais ce camion défiait la chronique. Au-delà du volume de cadavres abandonnés sous le soleil de l’État du Jalisco, il fut rapidement révélé que le camion était une morgue réfrigérée ambulante, propriété du Ministère de la justice du Jalisco [1].
Dans cette région du Mexique, les morgues « traditionnelles » sont pleines. Le gouvernement local achète donc des semi-remorques réfrigérés, afin de stocker les cadavres, qui sont entreposés sans être identifiés ou consignés dans un quelconque registre médico-légal. Dans le Jalisco, en dix ans, plus de 4 000 personnes sont officiellement portées disparues.
La violence contemporaine au Mexique : vivre durement, mourir facilement
Dans les médias mexicains, cet épisode fut rapidement englouti par les anecdotes qui nourrissent la « guerre contre la drogue » et son lexique, peuplé de termes comme « la violence », « les narcos », « les cartels », « le crime organisé », ou « l’État ».
Ce vocabulaire et sa litanie n’ont d’équivalent que les interminables listes de statistiques d’homicides, présentées comme l’alpha et l’oméga de l’analyse des crises que connaît le pays depuis 2006. Ils participent tous de la banalisation de la violence au Mexique : des mots et des chi
