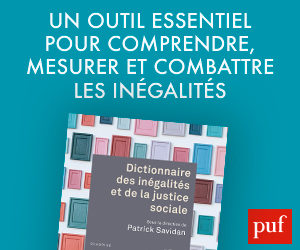De l’illisibilité du champ politique
Voilà plus de dix ans que les politistes ont attiré l’attention sur la montée des taux d’abstention chez les électeurs des classes populaires. L’aversion à l’égard du personnel politique qu’affirment, dans de multiples registres, tel ou tel porte-parole improvisé du « mouvement des gilets jaunes », le contournement des partis politiques et des organisations syndicales qu’exprime le recours aux réseaux sociaux, confirment, s’il en était besoin, la défiance d’une fraction au moins des classes populaires à l’égard de la représentation politique, sinon un refus banalisé de la remise de soi.
Pour ceux qui ont cru ou voulu voir dans le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 un « bouleversement du paysage politique », un « choc subi par le système politique français », force est de convenir au moins que le bouleversement a échappé aux « gilets jaunes » et à ceux qui s’y reconnaissent plus ou moins.
L’éditorial du Monde avait décrit ce « bouleversement » comme « prévisible et radical », « attendu et néanmoins surprenant ». « Prévisible », parce que la victoire d’Emmanuel Macron et la présence au 2ème tour de Marine Le Pen étaient annoncées par les instituts de sondages. « Surprenant » et « radical », à cause de « l’irruption fulgurante » d’Emmanuel Macron et de l’absence au second tour des « deux partis de gouvernement et d’alternance », le Parti Socialiste connaissant une chute historique et la droite une humiliation cuisante.
En fait, il semble surtout que le schème de perception ordinaire des exégètes politiques soit aujourd’hui désajusté à l’état du champ politique. Issue d’une longue sédimentation, l’échelle politique gauche-droite est, en effet, pour les instituts de sondages, les commentateurs politiques et sans doute aussi pour la plupart des électeurs, le schème de perception et le principe de classement dominant du champ politique français. Cette échelle est à la fois bipolaire et linéaire introduisant une extrême-droite, une extrême-gauche