Les syndicats dans la roue des gilets jaunes ?
Incontestablement, les syndicats ont ces derniers jours participé plus activement à l’effervescence créée par le mouvement des Gilets Jaunes. Ils étaient jusqu’alors plutôt restés en retrait, tardant et peinant à se positionner. Le mouvement s’est déclenché hors des entreprises et sur une question – le prix de l’essence – a priori assez éloignée des revendications touchant au travail. Malgré la prédominance des salariés, sa composition sociale l’ancre dans des secteurs hétérogènes de la population, incluant des petits patrons, commerçants et artisans et faisant craindre une révolte de type poujadiste. La visibilité de discours et d’actes xénophobes ou sexistes au début du mouvement semblait conforter cette tendance, justifiant la défiance des syndicalistes.
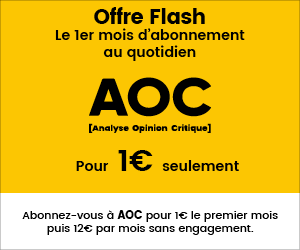
L’attention des confédérations était en outre concentrée sur des enjeux propres au champ syndical. L’affaire des fichiers à Force Ouvrière et la démission de son secrétaire général Pascal Pavageau étaient susceptibles d’éclabousser tout le mouvement syndical. Surtout, des scrutins décisifs mobilisaient l’ensemble des organisations syndicales. Il y eut d’abord en novembre les élections professionnelles dans deux bastions syndicaux du secteur marchand, la RATP et surtout la SNCF, où se jouaient non seulement l’épilogue du mouvement du printemps pour les cheminots mais aussi le basculement à haut risque vers des instances représentatives du personnel fusionnées suite aux ordonnances de 2017. Il y eut ensuite, le 6 décembre, le vote des 5 millions d’agents de la fonction publique. La dimension antifiscale qui caractérisait le mouvement des Gilets Jaunes dans ses premiers temps était d’autant plus problématique dans ce contexte de campagne pour la défense du statut des fonctionnaires et des services publics.
Le dialogue social comme sortie de crise ?
Le mouvement des Gilets Jaunes a progressivement basculé d’une éruption contre les « taxes » à une mobilisation populaire contre la vie chère et pour la justice fiscale.
