Le conflit syrien ou l’impossible construction de l’État moderne
Voilà plus de sept ans maintenant que la Syrie a basculé dans un conflit sanglant. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une organisation proche de l’opposition, il aurait fait à ce jour plus de 350 000 morts dont un tiers de civils et plus de 3 millions de blessés. Quelque 60 000 personnes seraient mortes sous la torture. Avec près de 6 millions de réfugiés dans les pays voisins (Liban, Jordanie, Turquie) ou en Europe, et autant de déplacés de l’intérieur – un syrien sur deux au total –, le pays a vu ses équilibres démographiques durablement modifiés. Le bilan de la guerre n’est pas moins dévastateur pour l’économie nationale qui aurait été ramenée trois décennies en arrière.
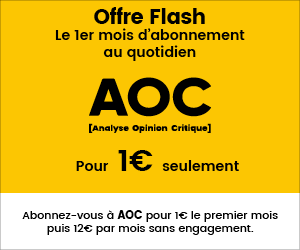
La question se pose de la nature d’un conflit dont la barbarie n’a d’égale que la complexité. Comment le qualifier ? Certains parlent de soulèvement populaire pacifique sauvagement réprimé par un pouvoir dictatorial disposant de gardes prétoriennes aguerries. D’autres, de guerre civile. A moins qu’il ne s’agisse d’un soulèvement devenu une guerre civile en même temps que d’une guerre régionale par Syriens interposés. L’éphémère printemps de 2011 avait commencé dans les périphéries : Deraa au Sud, plus tard Lattaquié au Nord-Ouest, la région de l’Euphrate à l’Est et les confins syro-turcs, des zones de forte implantation du parti Baas au pouvoir où les révoltés dénoncent l’accaparement des richesses par un pouvoir prédateur et une libéralisation mafieuse de l’économie. Á Deraa, la violence de la répression, qui n’épargne plus désormais les enfants et les adolescents torturés en prison, met le feu aux poudres : le régime a franchi le seuil de l’inacceptable et bafoué la plus élémentaire dignité humaine.
Encadrés par des comités de coordination, les protestations pacifiques se multiplient qui vilipendent la corruption et la tyrannie et en appellent à la chute du régime au nom de la justice et de la liberté. Appels à la grève, manifestations festives ou performances d’artistes voisin
