Colombie, une paix qui ne règle pas le conflit agraire
Le 11 novembre, au forum de la paix de Paris, le président colombien Iván Duque, arrivé au pouvoir en août dernier, vantait la trajectoire vertueuse du pays, qui lui aurait permis de clore la dernière guerre civile du continent américain et le plaçait résolument sur le chemin de la stabilité et du développement. Ses déclarations ont les plus grandes chances d’être saluées par les partenaires internationaux de la Colombie, dont la France. En effet, les accords de la Havane, signés en 2016, ont permis la démobilisation de la guérilla des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) en 2017 et sa participation en tant que parti politique aux élections de 2018, font figure de rare bonne nouvelle dans une actualité internationale anxiogène. Comment ne pas se réjouir de la fin d’un conflit qui depuis le début des années 1980 a coûté plus de 250 000 vies et généré le déplacement de plus de six millions de personnes ?
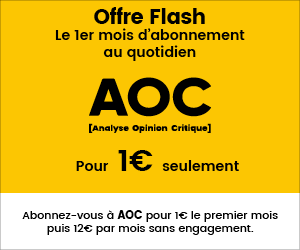
Les ambiguïtés de ce « post-conflit » ont été abondamment soulignées par des observateurs avisés. L’existence de groupes dissidents des FARC, qui n’ont pas accepté le mot d’ordre de démobilisation, les négociations qui pataugent avec l’autre groupe rebelle du pays, l’ELN, et surtout la violence des milices paramilitaires liées au narcotrafic, assombrissent le tableau que les autorités colombiennes s’efforcent de peindre.
Un sujet échappe cependant souvent aux commentateurs : alors que les négociations avec les FARC ont ouvert la porte à un timide élargissement de la participation politique, elles ont aussi acté la consolidation d’un modèle économique profondément inégalitaire, qui avait fourni le terreau de la rébellion. Cette réalité est particulièrement palpable dans les espaces ruraux du pays, où la violence est intimement liée aux conflits pour la terre, au pouvoir des grandes exploitations et à l’asservissement de la main d’œuvre agraire. La paix tant vantée fournit ainsi les bases d’un capitalisme d’après-guerre, dans lequel des formes de dominatio
