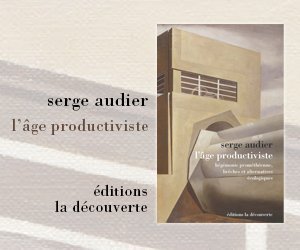La dangereuse fragilité du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel fait partie de ces institutions de la République relativement méconnues du grand public.
Il bénéficie périodiquement d’une certaine médiatisation : lors des élections présidentielles avec le recueil des fameux « 500 parrainages », lors du rendu d’une décision portant sur une loi ou une disposition législative cristallisant les oppositions politiques, ou encore à l’occasion de la nomination de nouveaux membres. Mais ce coup de projecteur sur le Conseil constitutionnel ne dure en général que quelques heures, il retombe rapidement dans un relatif anonymat.
Pourtant, et c’est tout le paradoxe, cette institution est certainement l’une des plus importantes de la Ve République.
En 60 ans, le Conseil constitutionnel s’est très largement transformé. Il est passé du rôle de simple organe chargé d’empêcher le Parlement d‘outrepasser ses compétences constitutionnelles, lui valant les surnoms peu glorieux de « canon braqué sur le Parlement » ou de « chien de garde de l’exécutif », au rôle de véritable juge constitutionnel « chien de garde des libertés et de la démocratie ».
Le Conseil constitutionnel se présente aujourd’hui comme une véritable cour constitutionnelle capable de censurer la loi du Parlement lorsque celle-ci viole la Constitution. Mais dans un pays qui a longtemps déifié la loi en la présentant comme l’expression de la volonté générale, l’idée qu’un collège de juges non élus puisse s’opposer à la majorité politique du moment pourrait apparaître incongru.
En particulier dans le contexte des « gilets jaunes » qui témoigne de la très grande défiance d’une partie des Français à l’égard de tout organe exerçant le pouvoir au nom du peuple et l’aspiration à davantage de démocratie directe.
Un Conseil constitutionnel garant de la démocratie et des libertés
Le rôle du Conseil constitutionnel n’est pourtant pas d’être un censeur de la démocratie, mais au contraire de la garantir. Outre ses fonctions en matière de contrôle des élections