La France Malheureuse
Depuis plus de deux mois, les blocages et manifestations organisés par le mouvement des « gilets jaunes » ont mis en évidence une vaste colère au sein de la population française. Le caractère disparate – et difficile à situer politiquement – des revendications émises, le profil sociologique des participants à ces actions indiquent que cette colère procède d’une insatisfaction profonde et générale d’une part notable des Français. L’augmentation du prix des carburants, plus liée à l’évolution du cours du pétrole qu’à la fiscalité carbone, n’aura été que le catalyseur qui a précipité l’expression de ce sentiment de mal-être.
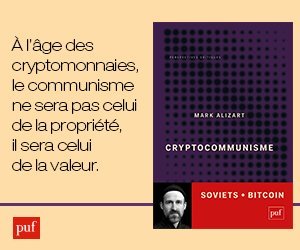
Il ne s’agit pour autant pas de la première irruption récente de ce mal-être sur la scène publique : dès le premier tour de l’élection présidentielle, le sentiment d’insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie a constitué un élément commun des votes d’extrême-droite et d’extrême-gauche. Dans l’espace politique français tel qu’il se redessine, l’opposition structurante ne porte plus tant sur les conditions matérielles de vie ou sur la place de la redistribution que sur deux éléments subjectifs : « Suis-je satisfait de ma vie ? » et « Fais-je confiance aux autres ? ».
Poser la question : « Dans l’ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie ? », en demandant une réponse sur une échelle de 0 – la pire vie possible à 10 – la meilleure vie possible, n’est pas une nouveauté. Cette question est posée depuis plus de cinquante ans aux États-Unis ou au Japon, et la Commission Stiglitz l’a désignée comme un des éléments-clefs d’un tableau de bord pour aller au-delà du PIB comme mesure du progrès économique et social.
Nous savons ainsi, sans surprise, que le chômage, de faibles revenus, un faible niveau de diplôme, l’isolement ou la dépression sont fortement associés à une faible satisfaction de vie. Il est plus inattendu de constater qu’à la question ci-dessus, la majorité des Français se positionnent à 7 ou 8 – donc relativement satisfaits de leur
