Le péril milicien au Sahel
Le récent massacre de 160 Peuls à Ogossagou au Mali s’insère comme un nouvel épisode particulièrement dramatique dans un cycle infernal de représailles entre terroristes islamistes et milices diverses dans le centre du pays, après la mort récente de 33 soldats maliens suite à une attaque jihadiste dans la même région.
Comme une réplique sinistre, des tueries intercommunautaires viennent de survenir le 3 février au nord du Burkina Faso, mêlées là aussi à une attaque jihadiste. Aujourd’hui, meurtres individuels et collectifs perpétrés par les jihadistes et les milices se multiplient dans le Sahel, comme si le triste exemple donné depuis quelques années par le Nord-Mali se diffusait progressivement et implacablement dans toute la région, sans souci des frontières.
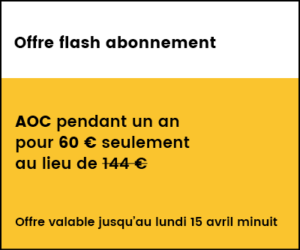
Attribué par la plupart des commentateurs à une milice dogon (version parfois contestée au Mali), ce massacre n’est qu’un pas de plus non seulement dans l’horreur, mais aussi dans la lente descente aux enfers de l’État malien, et, plus généralement, dans la dégradation de la situation au Sahel.
Ce conflit apparemment « ethnique » (si on en fait une lecture sommaire) renvoie en réalité à un enchevêtrement de plus en plus complexe d’antagonismes, de rivalités, de représailles et de violences qui a pour épicentre le Mali mais qui le déborde largement : concurrence de plus en plus aiguisée entre éleveurs et agriculteurs dans l’accès aux ressources et dans la gestion de l’espace, généralisation de la circulation des armes aujourd’hui facilement accessibles à tous à bas prix, multiplication et diversification des trafics en tous genres (drogue, cigarettes, armes, migrants), implantation des groupes jihadistes bien au-delà de leurs bases du Nord Mali (dans le Mali central, dans le Nord et l’Est du Burkina Faso, aux frontières Ouest, Nord et Est du Niger, sans parler des sanctuaires terroristes dans le Nord-Est du Nigéria, les confins du lac Tchad, et le Sud de la Lybie), prolifération des groupes armés et des milic
