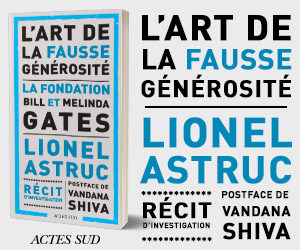Malaise dans la représentation
La mobilisation des « gilets jaunes » a donné à voir des situations de grande détresse sociale. Aux journalistes qui se tournaient vers eux à la faveur des événements, des participant.e.s ont expliqué qu’ils/elles n’avaient pas les moyens de chauffer leur maison l’hiver venu ou qu’elles/ils ne nourrissaient leur famille que de pâtes ou de pommes de terre dès le 20 du mois. Ces situations sociales sont habituellement invisibilisées dans les médias et dans les espaces de débats politiques. Les partis sont ainsi pris en flagrant défaut de représentation.
Car représenter c’est notamment donner à voir le monde social et, dans le cas analysé ici, les situations de détresse qui ont soudain affleurer dans le cours de ces mobilisations. Ce mouvement des « gilets jaunes » a touché certaines fractions des catégories populaires et intermédiaires : employés, ouvriers, travailleurs à temps partiel, notamment des femmes, auto-entrepreneurs en difficulté, retraités devant vivre avec des pensions inférieures à 1 000 euros par mois, salariés rémunérés en-deçà et autour du SMIC, mais aussi au-delà, couples d’actifs avec enfants obligés à diverses privations pour vivre avec leur budget de 3 000 euros par mois, petites professions indépendantes. Tous ont insisté sur leurs difficultés économiques liées non seulement à leurs niveaux de revenu, mais aussi à leur résidence dans des zones rurales ou périphériques qui les condamne à des usages contraints de l’automobile.
Ce sont ces catégories qui pâtissent au premier chef de la disparition des commerces et des médecins de proximité et des réductions des services publics (trains, écoles, hôpitaux, maternités, services postaux, centre des impôts, services administratifs) imposées avec obstination par les gouvernements de gauche ou de droite depuis de nombreuses années. De manière significative, ceux qui ont décidé l’augmentation de la « taxe carbone » ne se sont guère préoccupés des répercussions, pourtant intenables pour beaucoup d