L’impossible réussite du Grand Débat National
Le Grand débat national qui s’est tenu du 15 janvier au 15 mars dans un contexte de crise politique et sociale a donné lieu à de nombreux commentaires critiques, dubitatifs ou désabusés de la part d’observateurs comme du public ciblé par la participation. On a mis en cause la sincérité de la démarche, en regrettant qu’elle prétende permettre aux citoyens de participer, via une consultation ouverte à tous et organisée à l’échelon local, à l’élaboration « d’un nouveau contrat pour la Nation » tout en limitant fortement le périmètre du débat.
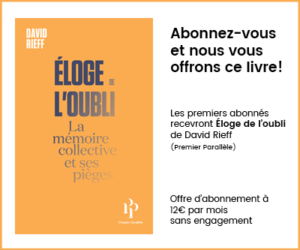
En corollaire des doutes sur la sincérité de la démarche, les doutes sur son utilité se sont fait entendre. S’est posée tout d’abord la question de la participation : quand Marlène Schiappa a justifié sa venue fin janvier sur un plateau télévisé par sa volonté de toucher ceux qui « n’auraient peut-être pas su comment participer au grand débat national et (…) transformer [leurs] plaintes en solution », elle a alimenté l’idée selon laquelle les personnes les plus concernées par ce débat ne sont pas celles qui s’y rendraient. Est venue ensuite la question de ce que l’on ferait de ce qui aura été produit. Alors que le débat vient de s’achever, les délais extrêmement courts que l’État se donne pour traiter la masse considérable des contributions qui en sont issues interrogent.
Si personne a priori ne remet en cause le principe d’une meilleure prise en compte de la parole des citoyens, alors à quoi tiennent les critiques ? On peut estimer qu’elles tiennent en large partie à la manière dont il a été conçu et dont il s’est déroulé – et donc à des limites relativement objectives –, mais pas seulement. Il semble en effet qu’il existe un doute assez partagé sur la possibilité qu’une telle initiative puisse faire réellement progresser la démocratie. On doute à la fois de la sincérité de ses initiateurs, à qui l’on prête des intentions cachées, et de la capacité à se mobiliser, voire à produire une contribution utile, de la cible visée par la
