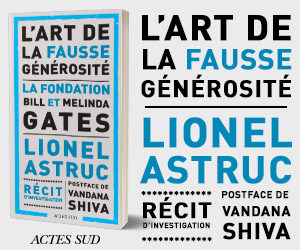Le centre du Mali, angle mort de l’intervention française ?
Le 26 mars, à la suite du massacre de plus de 160 civils, majoritairement peuls, dans le village d’Ogossagou, à proximité de Mopti – un carnage attribué aux miliciens d’autodéfense de Dana Amassagou liés aux confréries de chasseurs « traditionnels » dogons – le président de la Jeunesse de l’association Tabital Pulaaku cria au génocide :
« [Ces événements sont] sans précédents dans l’histoire du Mali, depuis la création de l’empire du Ghana, jusqu’à nos jours […] ; l’association Tabital Pulaaku invite tous les Maliens et toutes les Maliennes […] à marcher avec elle pour dire stop au génocide peul, car toutes les ethnies du Mali ont vécu en parfaite harmonie depuis des millénaires […]. Rappelez-vous que c’est exactement comme ça que certains pays africains ont connu petit à petit le génocide, notamment le Rwanda et le Burundi. Que Dieu nous en garde ».
L’évocation du scénario rwandais est doublement intéressante. Si, d’un côté, elle s’inscrit dans l’ethnicisation du discours politique de ces vingt dernières années, elle renvoie aussi aux lourdes responsabilités – directes ou indirectes – de la politique française et de la communauté internationale dans les massacres de 1994, qui se déroulèrent sous les yeux de la MINUAR. Or, au Mali, on le sait, la force française Barkhane et la MINUSMA, force onusienne, sont déployées sur le terrain.
L’analogie est supposée être frappante. Les deux missions, tout en disposant d’importants moyens financiers, politiques, militaires et civils, s’inscrivent dans une multiplicité de dispositifs mis en place après l’éclatement de la rébellion de 2012 : l’Accord d’Alger de 2015 et le Comité de Suivi de l’Accord (CSA), le G5 Sahel, l’EUTM Mali, l’EUCAP Sahel Mali vont de pair avec les actions que mènent les représentations diplomatiques in loco (Coopérations suisse, allemande, canadienne, néerlandaise…) et les financements conséquents attribués à toute une série d’ONG internationales et locales, sous le couvert d’une jungle de sig