Les maisons de santé sont-elles la panacée ?
La santé n’a pas vraiment fait partie des questions que le président de la République avait décidé d’aborder dans le cadre de son Grand Débat avec les français. Elle n’est cependant pas restée très longtemps à la porte car les témoignages et préoccupations des Français ont conduit les problématiques de l’accès, de la continuité et de la qualité des soins à être posées : fermetures de maternité, territoires à l’abandon, dégradation des conditions de travail pour les soignants, etc. Autant d’enjeux vitaux sur lesquels les français ont exprimé leurs inquiétudes.
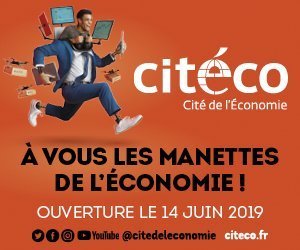
L’offre de soins se réduit pour diverses raisons et la désertification médicale est à l’œuvre dans plusieurs territoires. Les fermetures de lits dans les services hospitaliers soumis à la T2A (tarification à l’activité) amoindrissent les capacités d’accueil. Au-delà d’un problème d’offre, c’est aussi un problème d’organisation du système qui est apparu : le cloisonnement entre médecine hospitalière et médecine de ville par exemple ne permet pas des prises en charges coordonnées. Par ailleurs, le monde de la santé voit émerger de nouvelles pratiques professionnelles qui rendent acceptable l’exercice à temps partiel de la médecine.
Face à ces constats, des formes d’organisation des soins de premier recours se développent pour organiser l’accès à des soins en ville et constituer une alternative à l’hospitalisation en permettant un moindre recours aux urgences. Parmi ces formes d’organisation des soins, les « maisons de santé pluri-professionnelles », reconnues légalement en 2008 regroupent des médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, pharmaciens et autres professions. Elles ouvrent à ces professionnels libéraux un mode d’exercice collectif et coordonné de la médecine. Plébiscitées par le candidat Macron en 2017 comme par les autres prétendants à l’élection présidentielle, ces structures apparaissent comme une réponse à un certain nombre des enjeux d’accès aux soins de santé ma
