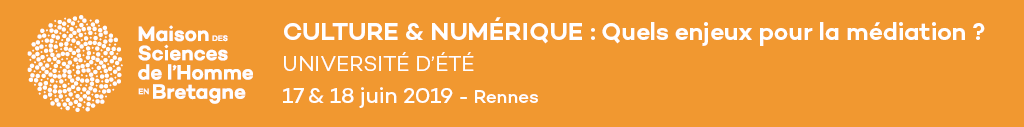Peut-on encore parler de régulation politique ?
La publication d’un ouvrage sur l’histoire de la régulation politique du XVIIIe au XXIe siècle, résultant d’une exceptionnelle mobilisation pluridisciplinaire, puis la préparation d’une nouvelle édition d’un ouvrage paru en 1998 sur ce même thème de la régulation politique[1] posent avec acuité le problème de la validité d’une conception classique de la régulation politique suggérant l’idée de maîtrise possible de l’action politique de même que celle du sens à lui donner grâce à la construction de théories portant sur le fonctionnement et le devenir des sociétés. Or, en la matière, la perte de croyance en un État tout puissant semble avoir définitivement sonné la fin de l’illusion : peut-on encore parler de régulation politique ?
Le temps des certitudes
L’histoire de la régulation politique est d’abord celle d’un espoir longtemps entretenu : celui de la réduction possible des incertitudes dans le gouvernement des hommes. L’histoire du politique, indissociablement avec celle du droit, témoigne d’une quête éperdue de scientificité par un recours à la « Science » en vue de maîtriser le pouvoir du politique et du droit comme instruments principaux de… la régulation des sociétés.
Sans pouvoir retracer ici cette histoire, rappelons simplement, qu’entre autres, Jeremy Bentham se tourne vers les mathématiques pour produire une « science de la législation », que, plus généralement, au XVIIIe siècle, le regard des spécialistes des institutions politiques va des sciences exactes (la logique et les mathématiques) vers les sciences physiques et de la nature, ou encore que la représentation de la Constitution s’inscrit dans une conception anthropomorphique de la société et de l’univers politique.
Rien n’illustre mieux cette vision que la pensée de Montesquieu quand il déclare « de même qu’on distingue chez l’homme la tête et les bras ou la volonté et l’action, de même on distingue dans l’État le pouvoir législatif, qui est la volonté et le pouvoir exécutif qui est l’ac