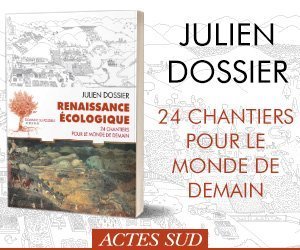Repenser le droit à l’heure de l’Anthropocène
L’Anthropocène est une nouvelle phase de l’histoire où l’espèce humaine deviendrait une force tellurique capable d’interagir avec les autres forces géophysiques et d’entraîner des conséquences durables pour notre écosystème. [1] Ces interactions ont été mises en lumière dans diverses perspectives scientifiques (géologie, sciences de la terre, géographie, climatologie) mais la prise de conscience est plus tardive dans les sciences humaines et sociales. Elle a commencé à atteindre le droit et la philosophie du droit à travers le droit dit « de l’environnement » et se cristallise plus particulièrement autour du dérèglement climatique, mais elle remonte plus loin.
Les sociétés sont désormais prises dans un mouvement de « collectivisation humaine » (Pierre Teilhard de Chardin) dit mondialisation, ou globalisation si l’on se réfère à la forme sphérique de la Terre. Dès la fin du 18ème siècle Kant fonde sur cette forme sphérique le droit à ne pas être traité en ennemi dans le pays où l’on arrive. Le principe « d’hospitalité universelle » s’impose selon lui parce que la dispersion à l’infini est impossible et que les relations de plus en plus étroites entre les peuples sont portées au point « qu’une violation de droits dans un lieu est ressentie partout». À son époque la planète abritait à peine un milliard d’êtres humains. Deux cents ans plus tard, la population mondiale avait triplé (1 milliard tous les 100 ans). Entre 1950 et 2010, s’ajouteront en soixante ans 4 autres milliards d’êtres humains (1 milliard tous les 15 ans !). Nous avons dépassé les 7 milliards et atteindrons bientôt 8 milliards. Autant dire que nous entrons dans une phase de compression, où le « serrage de la masse humaine » (Pierre Teilhard de Chardin), renforcé par la révolution numérique, accroît les interdépendances entre groupes humains (tribus, États, groupes d’États, entreprises) et plus largement entre les habitants, présents et futurs, humains et non humains, autrement dit entre le