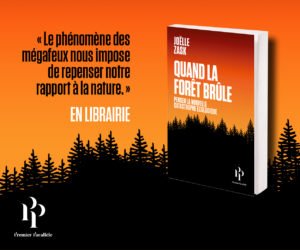L’univers invisible de la démocratie
La séquence des gilets jaunes a brisé la normalité de la vie politique sous la Ve République. On avait déjà vu se développer des mouvements sociaux pour la défense des salariés ou des mouvements sociétaux pour revendiquer l’égalité des femmes ou des homosexuels. On avait déjà vu se succéder de nombreuses grèves touchant le secteur public confronté à des réductions de moyens et d’effectifs, de l’hôpital à l’enseignement. La situation politique était devenue confuse depuis l’élection présidentielle de 2017 car la droite était exsangue, vampirisée sur le terrain des valeurs par le Rassemblement national et la gauche avait vu nombre de ses plus fervents défenseurs et de ses carriéristes les plus chevronnés se rallier sans barguigner au néolibéralisme macronien.
Le personnel politique avait sombré de plus en plus profond dans les baromètres de la confiance politique et suscitait désormais davantage de dégoût que de critiques. Mais il restait un point fixe, rassurant, qui consistait à considérer que la règle du jeu démocratique était largement partagée et que la Ve République avait finalement bien encaissé le choc des alternances successives et des changements de majorité alors même que bon nombre d’intellectuels attitrés nous avaient annoncé dans les années 1970 que le régime ne tiendrait pas en cas de cohabitation et tournerait très vite à la dictature.
Or le mouvement des gilets jaunes est venu nous dire autre chose. La brutalité de son surgissement a pris de court tous les tenants de la réforme constitutionnelle, de la réforme sociale et même du progressisme. Les syndicats étaient absents, La France Insoumise tenait enfin sa grande révolte sociale mais celle-ci lui échappait complètement sur le terrain politique, les élus de La République en Marche ne savaient pas quoi dire sur les plateaux de BFM-TV sauf fustiger l’explosion de violences.
Un président décontenancé est intervenu en décembre 2018 pour lâcher du lest fiscal face aux revendications sur le pou