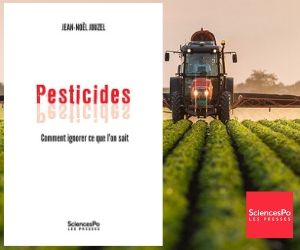L’artiste-chercheur ou quand les sciences sociales deviennent forme
Voir en l’art un domaine de recherche relevant des sciences sociales n’est en rien une aspiration nouvelle. Tantôt ténu tantôt fervent, ce désir a surgi dès l’émergence de ces champ disciplinaires et n’a cessé de réapparaître de manière cyclique, au gré d’enthousiasmes variablement distribués entre communautés scientifiques, artistiques et sphère sociétale.
Emportant pour la première fois l’adhésion collective dans l’Amérique des années 1960, il fait une puissante résurgence depuis les années 2000, au point de qu’en soit refaçonné l’enseignement artistique européen, que soient internationalement loués des critères créatifs de scientificité, et que s’impose dans l’imaginaire collectif une figure globalisée de l’artiste-chercheur[1]. En France, les débats qui ont accompagné ce retour en force se sont principalement articulés autour de la réforme des écoles d’art amorcée en 1999 par la signature des accords de Bologne.
L’homologation universitaire des parcours de formation artistique, l’implantation de doctorats en art, le recrutement d’enseignants habilités à diriger la recherche sont autant de sujets de crispation qui ont fini par cliver les discussions autour de positions de principe quant aux relations entretenues entre création et recherche. Pourtant, les enjeux idéologiques de cette porosité accrue entre gestes de l’art et pratiques d’exploration des faits sont demeurés peu questionnés. Que nous disent les efforts internationalement déployés pour encourager l’art à s’engager, à l’égal ou au côté des chercheurs, dans l’analyse du temps présent, de l’homme et des sociétés ?
Un tournant dans l’histoire politique des savoirs
Aborder cette question par le seul prisme de l’art conduit à reléguer aux angles morts de la pensée la mutation bien plus profonde qui s’est opérée, au cours des cinq dernières décennies, dans les champs imbriqués de l’épistémologie et de la fabrique politique des savoirs. Un détour par l’histoire est en effet nécessaire pour comprendr