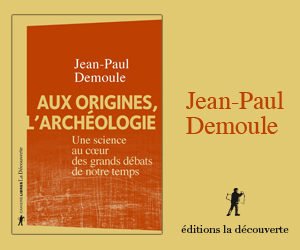Porto Rico, le pays invisible
À l’heure où la technologie permet d’obtenir des images de n’importe quel point du globe, certains pays n’en demeurent pas moins absents du regard de l’histoire et du discours mondialisé. Ce sont ces zones que l’écrivain portoricain Eduardo Lalo nomme les pays invisibles, expression qui donne son titre à l’un de ses essais autobiographiques (Los países invisibles). Construction géopolitique, historique et sociale, le partage du monde en lieux visibles et lieux invisibles façonne massivement les représentations, les discours et les pratiques de ceux qui les habitent. Il conduit notamment ceux qui peuplent les premiers à ignorer les seconds que, du fait de ce partage, ils ne sont pas en mesure de voir.
Le tracé de cette frontière est le fruit d’une histoire toujours écrite de la main des « vainqueurs » à l’encre de la violence, celle des armes ou celle des rapports économiques et sociaux. Le récit qui la soutient occulte totalement ce que l’historien Nathan Wachtel a appelé, à propos des Indiens du Pérou lors de la conquête espagnole au XVIe siècle, la « vision des vaincus ». L’invisibilité, en somme, n’est pas un effet de l’ignorance : elle est un rapport de force conduisant à un déficit de légitimité. Elle n’est pas tant d’abord une question de savoir que de pouvoir. Ce n’est qu’ensuite qu’elle conduit à l’ignorance.
Parler des lieux invisibles et de ce que l’on pourrait nommer la « condition d’invisibilité » – comme il est une « condition humaine » – c’est tenter de saisir ce qu’une telle condition fait peser sur ceux qui la vivent. Ce qui suppose, explique Eduardo Lalo, de distinguer deux façons d’être invisibles pour les lieux – quartiers, villes, provinces ou pays. Certains le sont, paradoxalement, par excès de visibilité, comme ces métropoles si prisées des touristes que leurs regards, avides d’authenticité, y butent de toutes parts les uns sur les autres, rendant leur objet inaccessible.
Et s’il lui arrive de se plaindre que ce spectacle-là annule c