Isolés ensemble – Vivre sans la ville abîmée ?
« L’intégration au système doit ressaisir les individus
isolés en tant qu’individus isolés ensemble »
Guy Debord
À l’approche des élections municipales de mars 2020, la ville apparaît comme une chose bien moribonde. Bien peu désirable. Bien peu prometteuse. Sans rien dire ici des espoirs que les habitants pourraient encore placer dans une quelconque politique municipale. Face à la prise de conscience grandissante du désastre climatique à venir et à une production de l’espace métropolitain toujours plus soumise aux impératifs marchands et aux enjeux de pouvoir, l’air de la ville semble irrémédiablement vicié et comme intrinsèquement vidé de ses possibles.
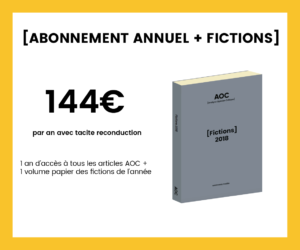
La ville, comme l’art romantique chez Hegel, apparaît au moment même de son hégémonie comme « une chose du passé ». Les anciennes vertus dont l’existence urbaine était parée jusque dans la tradition marxiste dont héritaient encore Henri Lefebvre ou Guy Debord (qui affirmait que « l’histoire de la ville est l’histoire de la liberté[1] »), à savoir : émancipation, exposition à l’altérité et à la diversité, réinvention de soi dans l’anonymat, etc. seraient aujourd’hui à remiser dans les vitrines des valeurs antiquaires. Car l’avenir semble se jouer nécessairement ailleurs que dans nos villes. Hors, entre ou contre nos villes.
Cabanes, forêts, montagnes, ruines, zones, archipels ; sortie, désertion, sécession, refuge, retraite, exode[2] ; trous, failles, brèches, interstices, marges : telles sont quelques-unes des figures de pensée aujourd’hui largement répandues dans une littérature à tous égards passionnante qui mobilise des imaginaires que l’on pourrait qualifier d’« alter-urbains ». Comme s’il s’agissait là du revers spatialisé ou territorialisé des imaginaires du « vivre sans » analysés par Frédéric Lordon dans son dernier ouvrage. L’imaginaire politique contemporain est ainsi en son essence foncièrement « hétérotopologique », à la recherche d’espaces autres. Ce qui signifie ici : d’espaces autres que ceux de
