Psychiatrie : gestion de la violence ou violence gestionnaire
L’hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, fut à deux reprises au cœur de l’attention médiatique au cours des 18 derniers mois. Comme souvent, la dernière actualité est plus présente dans les mémoires que la première. Il faut les rapprocher. La lecture révèle alors une situation bien énigmatique.
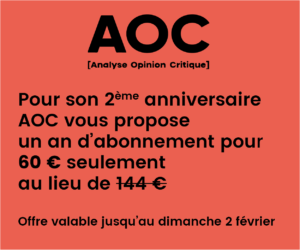
L’événement le plus récent date du 26 novembre 2019. Ce jour, une instance de surveillance publique des Droits individuels et du respect des conventions internationales, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, émettait une alerte sur l’hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen.
Constatant des « violations graves des droits fondamentaux », cette instance dénonçait les conditions d’accueil très dégradées des patients, reçus dans des unités surpeuplées, parfois enfermés dans des chambres d’isolement équipées d’un simple seau hygiénique. Mais le Contrôleur mettait également en cause les pratiques des professionnels, peu respectueuses des droits et de l’autonomie des malades : privation systématique de la liberté de se déplacer ou de choisir ses vêtements, mesures de contraintes utilisées sans contrôle, de manière abusive et banalisée. Les patients ne recevaient pas d’informations suffisantes sur leurs recours possibles. Le sort des « enfants », âgés de 12 ans et plus, faisait l’objet d’un point spécifique des rapporteurs. Ils dénonçaient leur placement en unité pour adultes, l’exposition à des menaces de la part des autres malades et l’utilisation de mesures d’isolement contraignantes.
En mars 2018, ce même établissement avait déjà été l’objet d’une attention médiatique, dans des circonstances quelques peu différentes. Plusieurs professionnels avaient entamé une grève de la faim, pour mettre un terme à la surpopulation des services et réclamer la création de postes de soignants supplémentaires. Ce mouvement social et la réponse des pouvoirs publics ont suscité des tensions locales. Une partie de l’établissement jugeait que le cœur du problème éta
