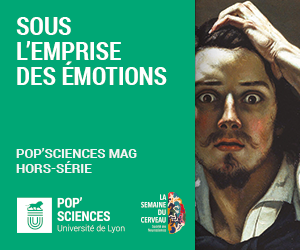Le virus et la Nation – regard historique sur la santé publique chinoise en temps de Covid-19
Dans son rapport publié le 28 février 2020, la mission conjointe OMS-Chine sur le Covid-19 étayait les conclusions suivantes : « La Chine a peut-être déployé les efforts de confinement des maladies les plus ambitieux, les plus agiles et les plus agressifs de l’histoire […] L’atteinte d’une couverture exceptionnelle par et en adhésion à ces mesures de confinement n’a été rendue possible que par l’attachement profond du peuple chinois à l’action collective face à cette menace commune ».
Le rapport décrit également une communauté internationale qui, en comparaison, ne serait « mentalement et matériellement pas prête à implanter les mesures employées en Chine ». Quelques jours plus tard, alors que le virus vient d’être déclaré urgence de santé publique de portée internationale, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disait se sentir « extrêmement concerné par l’accroissement du nombre de pays déclarant des cas, et plus particulièrement chez les pays disposant d’un système de santé plus faible ».
La pandémie du Covid-19 constituerait à ce titre un moment charnière pour tester la capacité de divers systèmes de santé à faire face à une telle crise. Un constat qui n’a pas échappé au neurologue de la Salpêtrière qui, le 27 février, interpelait déjà Emmanuel Macron sur le fait que cette crise sanitaire risquait, en France, de survenir sur un « hôpital fragilisé » par ses manques de moyens financiers et humains.
En comparaison, sous-entend-t-on, la Chine disposerait donc d’un système de santé robuste qui aurait prouvé son efficacité dans sa rencontre avec le virus. La capacité du pays à mettre entièrement en quarantaine une région de plusieurs millions de personnes, à y construire des hôpitaux en l’espace de dix jours et à développer un système de surveillance sanitaire à l’échelle nationale a en effet été particulièrement notée dans la presse.
La réactivité du pays et les moyens humains déployés auraient, à ce titre, constitué des facteurs esse