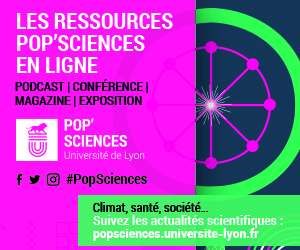Principes médicaux ou critères économiques : quand le système de soins choisit ses morts
Dès le 27 mars, dans l’émission de Jean-Jacques Bourdin, Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), l’affirmait : « Oui, il y a des témoignages qui effectivement nous racontent que oui, parfois, il y a des patients qui sont prioritairement pris et d’autres à qui on ne peut pas offrir une prise en charge identique. Donc aujourd’hui, il y a des choix douloureux parfois qui sont faits. » Depuis quelques jours, on pouvait en effet lire sur les réseaux sociaux le témoignage de soignant·e·s qui nous alertaient de la décision qui avait été prise dans certains hôpitaux de ne pas réanimer (« sauver ») certain·e·s patient·e·s.
On y apprend plus précisément que, face à la pénurie de lits de réanimation (7 000 en France contre 25 000 en Allemagne par exemple), de gel hydroalcoolique, de masques, de tests de dépistage, de surblouses, mais aussi de personnels soignants dont les effectifs, faut-il le rappeler, ont été drastiquement réduits ces dernières décennies, des médecins ont été contraints de faire un choix difficile, intolérable, entre les patient·e·s pouvant accéder aux soins de réanimation et ceux qui n’y auront pas accès. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France, s’en indigne en direct sur BFM TV le 29 mars à 19h40 : « Nous choisissons les patients aujourd’hui qu’on va mettre en réanimation », concluant, après avoir souligné l’existence d’un manque chronique de lits de réanimation en France, sur le caractère prévisible de la catastrophe.
L’état d’urgence sanitaire dans lequel nous sommes plongé·e·s depuis plusieurs semaines invite ainsi à lire ou relire les analyses menées par le médecin et anthropologue Didier Fassin, titulaire de la chaire annuelle de santé publique (2019-2020) au Collège de France, qui dans La Vie, mode d’emploi critique (Seuil, 2018), revient sur un paradoxe : « Jamais la vie n’a été aussi sacralisée dans nos sociétés occidentales. Mais ra