France – Rwanda : le temps des archives, le temps de l’histoire
« La France était là, présente au moment du dernier génocide du XXe siècle. Elle doit au monde des explications. La France doit réinterroger sa présence en Afrique. Il nous faut questionner les raisons de sa présence et ses objectifs pour qu’elle ne soit pas impliquée dans des paroxysmes sanglants. »
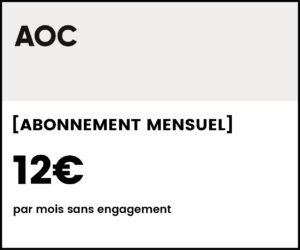
Sur les antennes de France Culture, le 13 avril 2019, à l’occasion de la 25e commémoration du génocide des Tutsi du Rwanda, le philosophe et politiste Achille Mbembe soulignait l’urgente actualité de l’établissement de la vérité sur la nature de l’engagement français au Rwanda entre 1990 et 1994. Il inscrivait cette question d’histoire dans le registre plus large des questionnements contemporains sur la place et le rôle de la France sur le continent africain.
Si le sujet a d’ores et déjà fait l’objet de nombreuses publications, une terrible controverse entrave cependant depuis la fin des années 1990 la bonne intelligibilité des faits par le public. Celle-ci oppose les tenants d’une responsabilité majeure jouée par la France au Rwanda entre 1990 et 1994 à d’anciens responsables politiques et militaires qui considèrent que la France a constamment œuvré en faveur de la démocratisation du Rwanda et de la paix. Ces discours sur le rôle exemplaire de la France entrent souvent en résonance avec des récits négationnistes qui tendent à minimiser le rôle de l’implication française dans le but d’équilibrer les responsabilités entre les acteurs et de rendre le FPR responsable du génocide des Tutsi.
Cette controverse se trouve en outre alimentée par le refus des autorités françaises d’autoriser l’ouverture générale des archives françaises[1] sur cette question extrêmement sensible où la France se trouve accusée de complicité de génocide[2]. Les enjeux d’une large ouverture des archives françaises sur le Rwanda sont donc lourds, entre écriture de l’histoire, déconstruction des discours de négation et avancées d’une justice qui pourrait se trouver saisie, plus de 25 ans après, le cri
