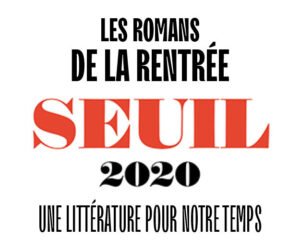Le défi démocratique de l’Europe d’après-crise
C’est par une lettre des quatre grands groupes du Parlement européen adressée le mercredi 26 août à la Présidente de la Commission européenne et à la Chancelière allemande (dont le pays assure la Présidence de l’Union) que se sont ouvertes les tractations sur le Cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027 comprenant le Plan de relance européen de 750 milliards d’euros tant attendu par les États membres. On peut penser que l’entrée en lice du Parlement européen dans le processus d’adoption de ce plan de relance ne sera pas vaine.
Comme souvent dans le processus législatif européen, certaines concessions pourraient lui être faites comme celle précisant la conditionnalité à l’État de droit des aides versées aux États ou encore comme le partiel rétablissement de certaines coupes budgétaires concédées aux « frugaux » lors du Conseil européen marathon de juillet dernier.
Force est de constater néanmoins que le Parlement européen intervient bien tard et comme à la marge dans cette négociation du Plan de relance. Davantage : aucune des décisions cruciales européennes qui ont émaillé la crise n’a été initiée par lui. Selon un schéma désormais bien arrêté au sein de l’Union, il n’aura ici son mot à dire qu’a posteriori, une fois que les grands cadres auront été arrêtés dans d’autres enceintes européennes que la sienne (Conseil européen, Conseil ou BCE en tête). En six mois, la crise a bien bouleversé le visage de l’Union européenne ; mais le Parlement européen, lui, a été jusqu’alors relégué au second rôle de ces évolutions.
Pourtant, l’accumulation de décisions iconoclastes durant la crise sanitaire a été frappante. Elles auraient pu être l’occasion de faire montre de son activisme ou même de le renforcer. La crise semble en effet avoir emporté tel un tsunami les dogmes de l’Union les mieux établis. L’inconcevable s’est produit avec une facilité que seules les grandes catastrophes permettent. Les blocs de granit qui formaient l’assise de l’Union ont été souff