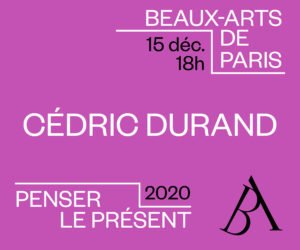Qu’attendre des expérimentations sociales pour réduire la pauvreté en temps de pandémie ?
En attribuant, l’an dernier, son prix à Esther Duflo, Abijit Banerjee et Miguel Kremer pour leur travail consistant à adapter la méthode des expérimentions par assignation aléatoire – les essais cliniques – utilisés en médecine aux interventions en matière de développement, le jury Nobel jugeait que ce nouveau type d’expérimentation, que l’on qualifiera de « sociales », a « considérablement amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté globale » et « à transformer l’économie du développement ». Un an après, l’explosion de la pauvreté à l’échelle mondiale due à la pandémie, tout particulièrement dans les pays du Sud, offre une occasion funeste mais exceptionnelle de questionner la capacité des expérimentations sociales à répondre à ce défi global.
A l’occasion de la publication d’un ouvrage de référence récemment paru (octobre 2020) mais finalisé avant la pandémie, nous faisons part ici de nos réserves. Si la méthode des expérimentations aléatoires dans le champ des politiques de développement est en apparence attractive, il y a peu de chances qu’elle offre des réponses à la hauteur des enjeux. Comme il n’est jamais judicieux de faire table rase du passé (Heckman, Chap. 13), que nous disent les 26 auteurs réunis dans cet ouvrage ?
Le principe des essais cliniques consiste à tirer au sort deux groupes au sein d’une population homogène : le premier reçoit un « traitement » (médicament, subvention, crédit, formation, etc.), le second un placebo, une intervention différente ou tout simplement rien ; à l’issue d’une certaine période, les deux groupes sont comparés afin de juger de l’efficacité de l’intervention ou d’en analyser deux modalités distinctes. Depuis le milieu du XXe siècle, cette méthode est couramment appliquée dans le domaine de la médecine, où elle suscite de nombreux débats. Cette méthode a ensuite été transposée à l’évaluation des politiques publiques dans des domaines de l’éducation, la criminalité, la fiscalité, etc., notamment aux État