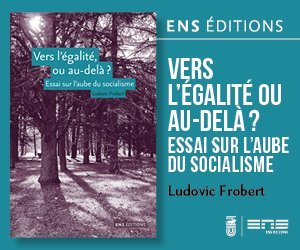Les « Printemps arabes », dix ans après
Dix ans après lesdits « Printemps arabes », la plupart des observateurs semblent surpris par les évolutions politiques des pays de la région, et la promesse non tenue de démocratisation. Surpris, désolés et peinés, autant qu’ils avaient été surpris, heureux et enthousiasmés par la chute de Ben Ali et celle de Moubarak, puis par la vague de contestation dans un grand nombre de pays du « monde arabe ». Ce constat n’est pas réservé aux journalistes, essayistes et publicistes en tout genre. Il concerne aussi les universitaires qui ont parlé de « transition démocratique » ou de « vague démocratique », puis de leur « échec », parfois de « régression », dans une analyse qui fait le plus souvent de l’autoritarisme une spécificité de ces pays – comme si, finalement, ces derniers étaient incapables d’assumer pleinement la démocratie.
S’il faut interroger cette « surprise », il faut plus encore interroger les analyses qui sont faites de ces pays. Autrement dit, qu’ont fait les travaux sur les « Printemps arabes » sur les sciences sociales ? Celles-ci ont été mises à l’épreuve à travers toute une série de présupposés, de points de vue et de considérations conceptuelles ou méthodologiques qui orientent la compréhension de ce qui s’est passé durant cette décennie, et en conditionnent les interprétations.
Il faut citer, d’abord, la façon dont les transformations sont appréhendées. Pour certains, le « Printemps arabe » constitue le Changement, tandis que d’autres mettent au contraire en avant le statu quo. Mais les uns et les autres ont en commun de prendre « l’événement Printemps arabe » en tant que tel, et de concevoir alors ces évolutions selon la « rhétorique du changement » telle que l’avait stigmatisée Peter Brown à propos de l’Antiquité tardive, c’est-à-dire en termes de grandes transformations identifiables, avec un avant et un après, dans une vision linéaire et prométhéenne de l’Histoire et l’illusion de la Révolution et du changement radical.
Cette compréhensio